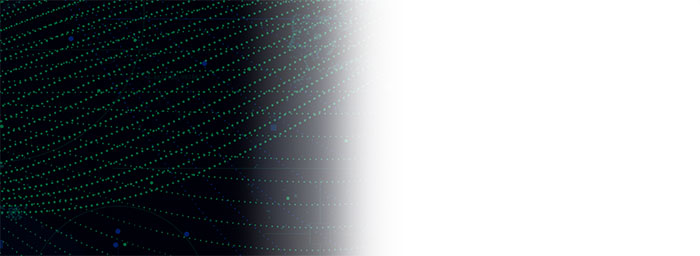Les étincelles du feu d’une guerre commerciale ont vacillé, grondé, puis culminé au cours de la dernière semaine, alors que les marchés asiatiques ont ressenti l’impact brûlant (suivi d’un apaisement momentané) des plans tarifaires du président Trump, marquant une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, et accentuant ainsi l'incertitude sur la croissance économique mondiale.
La semaine dernière, Trump a menacé la Chine d’imposer des droits de douane « réciproques » de 34 %. Beijing a décidé d’égaler ce chiffre. Le président américain a ensuite brandi la menace d’un droit de douane supplémentaire de 50 %, ce qui correspondrait à un taux de base stupéfiant de 104 % sur les produits chinois. Beijing n’a pas bronché, portant ses propres droits de douane sur les produits américains à 84 % et déclarant qu’elle « se battrait jusqu’au bout ».
En réponse, Trump a décidé d’augmenter les tarifs douaniers sur la Chine, les portant à 145 %, tout en annonçant une pause de 90 jours sur l’application de nouveaux tarifs réciproques. Cependant, un tarif de base de 10 % reste en vigueur, pour l'instant, pour la plupart des pays.
Aujourd’hui, les deux plus grandes économies du monde – dont le PIB combiné s’élève à 46 T$ US – se précipitent vers une guerre commerciale historique, avec très peu d’échappatoires possibles.
La Chine semble s’accrocher; mardi, les sociétés d’investissement d’État chinoises, guidées par les autorités financières, ont lancé un effort coordonné pour soutenir le marché chinois en perte de vitesse. Beijing a également dévoilé les contrôles à l’exportation d’un ensemble de terres rares et a inscrit sur sa liste noire 27 entités américaines, allant de groupes de défense à des fabricants de drones. Le président chinois Xi Jinping a également appelé à « relancer pleinement » la consommation intérieure alors que les exportations risquent de chuter.
Lundi, les marchés asiatiques se sont effondrés; l’indice Nikkei du Japon a dégringolé de 7,9 %, tandis que l’indice de référence de Hong Kong a subi sa plus forte baisse depuis 1997. Toutefois, les marchés, qui ont oscillé pendant des jours, sont remontés après l’annonce d’accords potentiels entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux privilégiés.
Heureux soient les négociateurs
Les principaux alliés des États-Unis dans la région indo-pacifique, paralysés par leur dépendance à l’égard du parapluie de sécurité américain, cherchent à réduire la tension sur la question des droits de douane.
Le premier ministre japonais Ishiba Shigeru, dont le pays est soumis à des droits de douane réciproques de 24 %, s’est brièvement entretenu avec Trump lundi, et les deux parties ont convenu de nommer des négociateurs au sein du cabinet. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré à Fox News que « le Japon aura la priorité » et que les négociations avec d’autres pays – que Trump avait exclues la semaine dernière encore – se poursuivront au cours des prochains mois.
M. Trump s’est également entretenu avec le président par intérim de la Corée du Sud et a laissé entendre qu’un « excellent accord pour les deux pays » était possible. Séoul, qui a envoyé son plus haut responsable commercial à Washington mardi, est confronté à des droits de douane réciproques de 25 % de la part des États-Unis.
De son côté, Taïwan a déclaré qu’elle ne prendrait pas de mesures de rétorsion à l’encontre d’un droit de douane réciproque de 32 %. Le président taïwanais Lai Ching-te a proposé un accord bilatéral de « droits de douane nuls » avec Washington.
Le Canada est l’une des rares cibles, avec la Chine et l’Union européenne, à prendre des mesures de rétorsion à l’encontre des États-Unis. Hier, Ottawa a imposé des droits de douane de 25 % sur certains véhicules américains importés au Canada.
L’ANASE réfléchit à une réponse
Les pays d’Asie du Sud-Est sont particulièrement vulnérables aux droits de douane de Trump, car nombre d’entre eux maintiennent des excédents commerciaux élevés avec les États-Unis et dépendent du pouvoir d’achat des consommateurs américains.
Le Laos, par exemple, a exporté pour 803,3 M$ US de marchandises vers les États-Unis en 2024, mais ses importations n’ont atteint que 40,4 M$ US. Le Cambodge est confronté à un excédent tout aussi disproportionné et doit maintenant faire face à des droits de douane réciproques de 49 %. Le Vietnam est également menacé : ses exportations de marchandises vers les États-Unis représentaient 30 % de son PIB en 2024.
Ces trois pays sont membres de l’ANASE, qui tente d’élaborer une réponse collective aux droits de douane américains. L’ambassadeur itinérant de Singapour a récemment déclaré que les membres de l’ANASE « considèrent […] les nouveaux accords commerciaux comme une possibilité de diversification. Nous savons qu’il ne s’agit pas de remplacer les États-Unis, mais nous voulons répartir nos efforts. »
Quatre pays membres de l’ANASE, soit le Brunéi, la Malaisie, Singapour et le Vietnam, font déjà partie de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, et d’autres pourraient s’y joindre prochainement : l’Indonésie a déposé une demande d’adhésion en septembre 2024. L’ANASE cherche également à améliorer les accords commerciaux préexistants avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine.