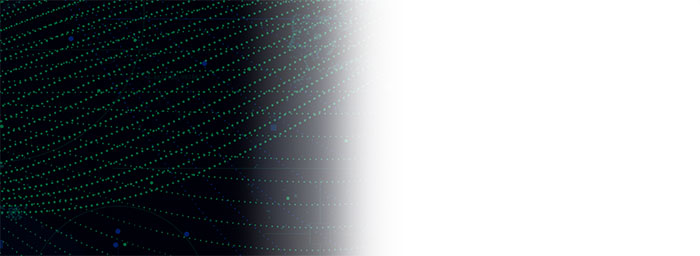Au cours des vingt dernières années, la Chine a ancré sa présence dans les ports du monde entier, étendant ainsi son contrôle et son influence sur des routes de livraison critiques et des pôles de ressources vitales. Le pouvoir et l’influence de la Chine ne se limitent pas aux affaires commerciales : plusieurs de ces ports pourraient avoir des fonctions à double usage, à la fois commerciales et militaires, et sont devenus de nouveaux points de tension dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine, particulièrement maintenant que les deux parties semblent accroître leur commerce et leur militarisation.
Le récent bras-de-fer autour du contrôle des ports le long du canal de Panama, une artère majeure de la livraison mondiale, présage la manière dont cette compétition pourrait se jouer ailleurs.
Jusqu’en 2024, la Chine a investi dans au moins 129 ports sur presque tous les continents (l’Antarctique étant la seule exception). Quatorze de ces ports sont devenus inactifs en raison d’inquiétudes environnementales, financières, ou de détérioration des relations politiques avec les pays hôtes. Bien qu’aucun capital chinois ni secteur privé chinois ne soient actuellement présents dans les ports canadiens, les inquiétudes sur la sécurité persistent. Parmi celles-ci figurent les vulnérabilités potentielles des infrastructures fabriquées en Chine, largement utilisées dans l’un des points d’entrée les plus critiques au Canada, notamment le port de Vancouver.
Quand et comment la Chine est-elle devenue une puissance portuaire mondiale ?
Aujourd’hui, plus de 95% du commerce international de la Chine se fait par voie maritime ; par conséquent, une infrastructure maritime fiable est impérative et stratégique pour le pays. Les efforts de la Chine pour accroître son influence sur les ports autour du monde sont motivés non seulement par des ambitions commerciales, mais aussi par le souhait de sécuriser les chaînes d’approvisionnement critiques et de réduire sa dépendance vis-à-vis des points de contrôle maritimes vulnérables, tels que le détroit de Malacca et le canal de Suez. Le contrôle des ports permet de garantir un flux stable pour les importations essentielles, allant des aliments et de l’énergie aux minéraux critiques.
Ces priorités ont commencé à se concrétiser autour de 2001, lorsque la Chine a rejoint l’Organisation mondiale du commerce. À cette époque, le pays faisait face à une raréfaction croissante des ressources et à une surproduction interne. Pour répondre à ces enjeux, Beijing a formalisé sa stratégie d’expansion internationale, encourageant à la fois les entreprises publiques et privées à investir à l’étranger, notamment dans les pays en développement riches en ressources et au fort potentiel de marché. Cependant, les infrastructures portuaires sous-développées dans plusieurs de ces pays ont constitué des barrières importantes au commerce. Le développement des ports est ainsi rapidement devenu un point d’intérêt majeur pour les investissements chinois sortants.
Au début des années 2010, Pékin a redoublé d’efforts pour accroître son influence économique et politique avec le lancement de la nouvelle route de la soie, un vaste plan pour bâtir des infrastructures maritimes et terrestres à travers l’Eurasie, l’Afrique et l’Amérique latine. Appuyées par un soutien étatique important, les entreprises chinoises ont rapidement intensifié le financement et la construction de ports à l’échelle mondiale. Entre 2013 et 2017 seulement, les entreprises chinoises ont été impliquées dans le développement d’au moins 52 projets portuaires à l’étranger.
En parallèle de cette expansion portuaire, la Chine a également élaboré un projet militaire complémentaire considéré comme essentiel pour protéger ses intérêts croissants à l’étranger. Beijing a formalisé cette réorientation dans sa stratégie militaire de 2015, qui précise le rôle de l’Armée populaire de libération (APL) dans la protection des intérêts du pays outre-mer, incluant les ressources énergétiques, les routes maritimes de transport et les investissements. En 2017, Pékin a annoncé son plan d’accroissement de son corps des Marines d’environ 400%, incluant le déploiement de troupes dans des ports opérés par la Chine, notamment à Djibouti en Afrique de l’Est et à Gwadar au Pakistan.
Où est-ce que la Chine construit des ports ? Et pourquoi l’emplacement est-il important ?
L’Afrique est la première destination des investissements chinois dans le secteur portuaire, les entreprises chinoises étant impliquées dans 78 ports, soit un tiers des ports du continent. L’Afrique de l’Ouest, où se trouvent de vastes réserves de pétrole et de minéraux critiques, était la principale bénéficiaire de cet investissement. En revanche, la côte est du continent, première base militaire chinoise outre-mer située à Djibouti, n’est qu’à quelques kilomètres des sites militaires américains et de leurs alliés.
L’activité portuaire chinoise est également très présente en Amérique latine. Alors que l’influence américaine dans la région s’est estompée, celle de la Chine a crû, notamment après l’achèvement du port de Chancay en 2024, au Pérou, où se trouvent certaines des plus importantes réserves mondiales de cuivre et de zinc. Désormais troisième plus grand port d’Amérique latine et des Caraïbes (après Santos au Brésil et Manzanillo, sur la côte ouest du Mexique), Chancay pourrait réduire de 20 jours, les délais de livraison entre la Chine et l’Amérique latine, tout en permettant aux exportateurs sud-américains d’éviter les ports américains et mexicains dans leurs échanges avec l’Asie.
Cette expansion des infrastructures portuaires est étroitement liée à la dominance croissante de la Chine dans la région, qui est désormais le principal partenaire commercial de l’Amérique du Sud. Les exportations chinoises dans la région ont connu une croissance exponentielle ces deux dernières décennies, passant de 12,7 milliards de dollars américains en 2002 à 303,7 milliards en 2022, soit une multiplication par 22. Ces exportations consistent principalement en biens industriels à forte valeur ajoutée, notamment des véhicules, des téléphones portables et des ordinateurs. Parallèlement, les importations sud-américaines comprennent plusieurs produits agricoles. En assurant l’accès aux minéraux critiques et aux denrées alimentaires, la Chine se prémunit contre la dépendance aux technologies et exportations des États-Unis.
Pourquoi les États-Unis et leurs alliés s’inquiètent-ils ?
Pour les États-Unis et plusieurs de leurs alliés, le réseau croissant de ports chinois n’est pas uniquement perçu comme une activité commerciale, mais plutôt comme une manœuvre réfléchie pour étendre la présence militaire et le pouvoir géopolitique de la Chine.
L’inquiétude principale est que la Chine puisse instrumentaliser ses implantations pour perturber les chaînes d’approvisionnement, bloquer l’accès aux matières premières et autres biens critiques, et engendrer une instabilité plus large sur le marché mondial. Ces préoccupations vont au-delà du contrôle chinois sur les quais et concernent également les composants d'infrastructures installés par la Chine, tels que les grues et les systèmes de surveillance.
Autres sources d’inquiétudes sont plus explicitement de nature militaire. Comme évoqué précédemment, certains ports liés à la Chine sont situés près de sites militaires américains, tels que le port Doraleh, à usage multiple, à Djibouti, où la Chine est un grand investisseur. Ce port se trouve à 12 kilomètres du Camp Lemonnier, la plus grande base militaire américaine en Afrique. De même, aux Émirats arabes unis, le port de Khalifa, opéré par un conglomérat maritime chinois, est situé à environ 80 kilomètres de la base aérienne américaine dans le golfe Persique. Washington craint qu’en cas de crise, Beijing puisse utiliser son influence sur ces ports pour surveiller, interdire ou restreindre un déploiement militaire américain.
Ces risques s’aggravent à cause de la dépendance des forces américaines à la logistique commerciale. Environ 90% de ces transit de fret se fait par des navires commerciaux, offrant potentiellement aux opérateurs portuaires une visibilité sur le calendrier et l’envergure des opérations des États-Unis. Une inquiétude majeure concerne les équipements fabriqués par des entreprises chinoises. À titre d’exemple, Zhenhua Heavy Industries Company Limited (ZPMC), une entreprise étatique chinoise d’ingénierie, fournit environ 70% des grues portuaires dans le monde. Ces grues pourraient offrir à Beijing un accès dissimulé à des données sensibles sur les cargaisons, y compris des détails sur les équipements militaires américains. Même dans les ports qui ne sont pas directement sous contrôle d’entreprises chinoises, l’installation extensive de caméras de surveillance et de systèmes de suivi fabriqués en Chine constitue un autre vecteur potentiel d’espionnage.
Au final, il existe une appréhension aux États-Unis et chez ses alliés que la Chine puisse exploiter son accès mondial aux ports pour la pré-position de missiles, de munitions et autres équipements sous prétexte d’usage civil, si un conflit militaire venait à éclater. Au moins 14 ports outre-mer appartenant à la Chine sont supposément capables de soutenir des opérations maritimes, augmentant les chances que Beijing puisse s’en servir pour réarmer et réapprovisionner ses forces loin de son territoire.
Comment les États-Unis répondent-ils ?
Les États-Unis ont tenté de bloquer les accords portuaires chinois, particulièrement dans des emplacements qu’ils considèrent stratégiquement sensibles. Par exemple, en 2021, Washington a fait pression sur la Croatie pour annuler un accord avec la Chine visant à construire et exploiter un terminal moderne à conteneurs à Rijeka, un port en eau profonde donnant un accès direct aux marchés d’Europe centrale. Ce contrat a finalement été attribué à une entreprise danoise.
En mai 2025, une firme américaine liéeà Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la Défense, cherchait à acquérir le port de Darwin, actuellement en contrat de bail pour 99 ans avec une entreprise chinoise. Ce port est un atout stratégique sur la côte nord de l’Australie, proche des bases militaires américaines et australiennes. En 2024, il a été révélé que les États-Unis ont investi des centaines de millions de dollars dans la construction d’installations aériennes à Darwin, dans le cadre d’efforts visant à contrer la présence chinoise croissante dans l’Indo-Pacifique.
Le Congrès américain a également introduit une législation bipartisane en février 2025, intitulée Strategic Ports Reporting Act (Loi sur la déclaration des ports stratégiques), qui obligera les agences fédérales à identifier les ports nationaux et étrangers vitaux pour les intérêts militaires, diplomatiques, économiques et en matière de ressources des États-Unis, ainsi qu’à surveiller les tentatives chinoises de prise de contrôle de ces ports.
Le prochain grand indicateur de la détermination américaine sur cette question sera probablement lié au canal de Panama. Ce canal constitue un point de connexion maritime critique entre les côtes est et ouest américaines ainsi que l’Europe, facilitant le commerce intercôtier au sein des États-Unis.
En temps normal, le canal est la route commerciale la plus rapide connectant ces deux côtes américaines. Plus de 74% des échanges commerciaux passant par cette voie maritime ont pour origine ou destination les États-Unis, ce qui en fait le principal utilisateur du canal. Ce passage est particulièrement crucial pour la stratégie américaine d’utilisation de l’énergie comme instrument diplomatique dans l’Indo-Pacifique, puisqu’il constitue la principale voie pour les exportations américaines d’énergie, notamment le pétrole brut, les carburants raffinés, le gaz naturel liquéfié ainsi que le pétrole brut canadien réexporté via les terminaux américains vers les marchés asiatiques.
Sur le plan sécuritaire, le canal est central pour le déploiement des navires américains, permettant leur transfert fluide entre les océans Atlantique et Pacifique. La perte de cet accès pourrait retarder de plusieurs semaines le déploiement des navires américains dans le Pacifique.
En mars, sous la pression américaine, une entreprise de Hong Kong, CK Hutchison, a annoncé qu’elle vendrait ses droits sur l’exploitation de trois ports, dont deux au Panama, à un consortium comprenant la société américaine BlackRock. Beijing a rapidement réagi en lançant une enquête pour pratiques anticoncurrentielles dans l’espoir de suspendre la transaction.
Après l’expiration de la période de négociation exclusive avec BlackRock en juillet, CK Hutchison a ouvert la porte au géant public chinois Cosco, qui cherche actuellement à acquérir une participation de 20 à 30% dans la future propriété du portefeuille portuaire de CK Hutchison. Au final, la décision reviendra au gouvernement panaméen, le président José Raúl Mulino étant supposément en train de décider si le contrat portuaire avec CK Hutchison sera annulé, en raison de plaintes locales visant à annuler la mainmise du groupe sur les ports.
Beijing a de fortes incitations pour retarder la vente ou en sécuriser une part. Le groupe Hutchison est présent dans 23 pays, sur des routes maritimes majeures, notamment aux Bahamas et autres axes reliant les États-Unis et l’Ukraine. Céder ces actifs à des mains occidentales représenterait plus qu’un revers commercial ; cela pourrait impacter les ambitions de puissance mondiale de la Chine tout en privant Beijing de relais politiques précieux en période de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.
Quelles implications et quels intérêts la Chine porte-t-elle pour le Canada ?
Tant les entreprises publiques chinoises que CK Hutchison ont exploré des opportunités pour agrandir l’infrastructure portuaire au Canada, mais celles-ci n’ont jusqu’à présent pas abouti. En 2015, China Communications Construction Company a proposé de développer un terminal à conteneurs à Sydney, en Nouvelle-Écosse, mais le projet a été discrètement mis de côté en raison du tournant dans les relations bilatérales en 2018. Une autre initiative pour un terminal de 775 millions de dollars canadiens, incluant CK Hutchison et le port de Québec, a été annulée par le gouvernement fédéral en 2021 pour des raisons environnementales.
Le nord canadien, riche en ressources, est également sur le radar de Pékin, qui cherche à pallier les lacunes en matière d’infrastructures et à acquérir un accès aux dépôts de minéraux critiques. Cependant, les inquiétudes croissantes concernant la sécurité nationale ont poussé Ottawa à devenir plus prudente vis-à-vis des investissements chinois. Le gouvernement a de plus en plus utilisé des outils politiques tels que la Loi sur Investissement Canada pour filtrer les investissements étrangers provenant d’entreprises étatiques, rendant plus difficile pour le capital chinois de trouver un emplacement. Notamment, en 2020, Ottawa a bloqué la prise de contrôle proposée d’une mine d’or au Nunavut par une entreprise publique chinoise, suite à une évaluation pour des raisons de sécurité nationale sous cette loi.
Cependant, les ports canadiens ne sont pas à l’abri de l’influence de Beijing. Les ports de Halifax, Prince Rupert et Vancouver dépendent des grues fabriquées par ZPMC, une entreprise chinoise dont le matériel a été identifié par les autorités américaines comme posant un risque potentiel de surveillance pouvant paralyser les opérations portuaires. Au port d’Halifax uniquement, sept des neuf grues ont été construites par ZPMC. Si le matériel chinois est souvent choisi principalement pour ses coûts avantageux, les inquiétudes liées à la cybersécurité deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. En 2023, Transports Canada a affirmé ne pas être au courant de cas où les équipements de grues aux ports canadiens ont été utilisés pour la surveillance ou la perturbation, mais qu’il collectait davantage de données spécifiques aux grues pour mettre à jour cette évaluation sécuritaire. Cependant, aucun détail sur les actions entreprises n’a été communiqué au public.
• Édité par Vina Nadjibulla, vice-présidente de la recherche et de la stratégie, Erin Williams, gestionnaire principale de programme, et Ted Fraser, rédacteur en chef à FAP Canada.