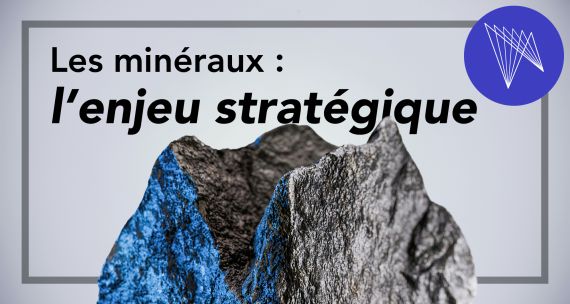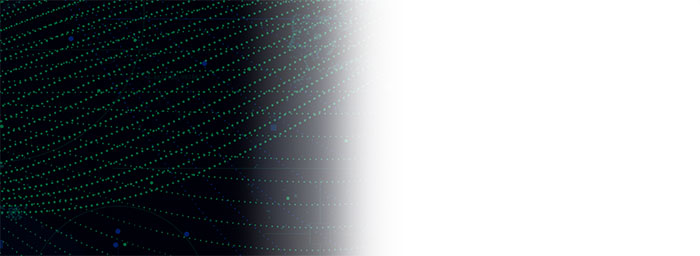Alors que les tensions géopolitiques et les frictions avec les États-Unis augmentent sous l’administration Trump 2.0, le Canada reconnaît la nécessité d’une plus grande autonomie dans la production d’équipement militaire et cherche à diversifier ses partenariats en matière de défense. L’Arctique est l’une des principales régions où la Russie, le plus grand État arctique, continue d’étendre son empreinte militaire et commerciale. Bien que la Chine ne soit pas frontalière de l’Arctique, elle s’est déclarée « État quasi arctique » et multiplie régulièrement ses activités stratégiques dans la région. L’importance de l’Arctique n’a fait que croître à mesure que la fonte des glaces débloque l’accès au pétrole, au gaz et aux routes maritimes vitales. En réponse, le premier ministre canadien Mark Carney a récemment annoncé des plans visant à renforcer la présence militaire du Canada dans le Nord, soulignant l’importance croissante de la région dans la planification de la défense nationale.
Dans ce contexte, la coopération trilatérale entre le Canada, la Corée du Sud et le Japon constitue une occasion opportune. Les forces industrielles des partenaires du Canada dans le Nord du Pacifique – dans les domaines de la défense, de la construction navale et de la robotique – concordent avec les priorités d’investissement du Canada dans les systèmes de surveillance, les plateformes militaires autonomes, la défense maritime et l’équipement capable de fonctionner dans l’Arctique. À l’inverse, les secteurs de haute technologie de Séoul et de Tokyo – qui dépendent fortement encore de minéraux critiques d’origine chinoise – bénéficieraient d’une intégration en amont avec la base de ressources du Canada. Grâce à ses vastes réserves, le Canada peut offrir des intrants stables pour des composants clés comme les capteurs, les piles et les alliages, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement des produits de défense sud-coréens et japonais qui, à leur tour, soutiennent la sécurité du Canada dans l’Arctique.
Du point de vue d’Ottawa, une plus grande coopération trilatérale s’alignerait également sur sa stratégie de 2022 pour l’Indo-Pacifique, qui présente le Japon et la Corée du Sud comme des partenaires clés pour un engagement stratégique et économique plus profond dans la région. Plus important encore, des experts ont constaté que, contrairement à la Chine, qui cherche à jeter les bases de futures revendications de partie prenante dans l’Arctique, la Corée du Sud et le Japon se sont davantage concentrés sur la participation à travers les structures de gouvernance existantes dans l’Arctique. En janvier 2020, la Corée du Sud a lancé le « Club arctique en Corée » pour réunir des ambassadeurs des États arctiques, dont le Canada, afin de promouvoir la coopération en matière de conservation. De même, la politique arctique du Japon comprend son leadership dans l’élaboration d’accords environnementaux mondiaux tels que le protocole de Kyoto et les cibles de biodiversité d’Aichi et met l’accent sur la contribution au développement durable de l’Arctique.
L’Arctique canadien a besoin de navires sud-coréens et de satellites japonais
Les récentes activités militaires russes et chinoises dans l’Arctique rendent la défense de la souveraineté nordique du Canada non négociable. Les États-Unis étaient auparavant considérés comme un partenaire fiable pour soutenir la défense nordique du Canada; cependant, le retour de l’administration Trump en 2025 – marqué par des remarques sur l’acquisition du Groenland, des prétentions à annexer le Canada en tant que « 51e État » et l’imposition de tarifs douaniers priorisant les É.-U. – a rapidement et considérablement miné cette confiance. À la lumière de ces développements, le Groupe d’experts sur les relations entre le Canada et les États-Unis a demandé au Canada de diversifier ses partenariats en matière de sécurité et, surtout, d’assumer une plus grande responsabilité pour assurer sa propre sécurité.
La stratégie Notre Nord, fort et libre (NNFL) du Canada, publiée en avril 2024, établit un plan pour la souveraineté arctique, la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et une plus grande autosuffisance en matière de défense. S’engageant à verser 73 milliards $ CA sur 20 ans, le plan vise à augmenter les dépenses de défense à 1,76 % du PIB d’ici 2030. L’expansion de la défense du Canada dans l’Arctique est un élément essentiel de la stratégie NNFL, notamment l’acquisition de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle capables de rester sous la glace, un investissement de 9,4 milliards $ CA dans l’approvisionnement en munitions, 2,6 milliards $ CA pour des systèmes d’artillerie à longue portée afin de remplacer les systèmes vieillissants et d’égaler la puissance de feu des autres et un investissement de 18,4 milliards $ CA pour de nouveaux hélicoptères tactiques adaptés aux conditions extrêmes du Nord.
La Corée du Sud est particulièrement bien placée pour soutenir l’approvisionnement du Canada en matière de défense arctique. Contrairement à de nombreuses entreprises occidentales, le secteur sud-coréen de la défense bénéficie de cycles de production continus soutenus par les tensions avec la Corée du Nord, ce qui permet une fabrication et une livraison rapides. En tant qu’allié des États-Unis depuis 1953 et avec des décennies d’exercices militaires conjoints semestriels, la Corée du Sud développe également des systèmes compatibles avec les normes de l’OTAN et des États-Unis, comme en témoigne l’automoteur d’artillerie K9 de Hanwha. En effet, Hanwha a exprimé son intérêt actif à offrir le K9 au Canada. En juillet de cette année, une délégation d’envoyés présidentiels, dirigée par l’ancien général quatre étoiles et actuel législateur Kim Byeong-joo, s’est rendue au Canada pour plaider en faveur d’une plus grande participation de la Corée du Sud à la modernisation de la défense du Canada, en particulier les futurs programmes de sous-marins et d’artillerie.
Dans le domaine de l’aviation, les hélicoptères tactiques économiques de la Corée du Sud offrent une solution opportune au besoin de moderniser la flotte vieillissante du Canada et d’améliorer l’intervention rapide dans l’Arctique. En outre, la fabrication de sous-marins en Corée du Sud, dirigée par Hanwha Ocean et HD Hyundai Heavy Industries, qui ont soumissionné conjointement pour le programme de sous-marins de 20 milliards $ US du Canada, s’inscrit directement dans le cadre de l’expansion navale sous la glace du Canada.
Le Japon apporte également une expertise essentielle dans la production militaire. Son leadership dans la construction navale de pointe, en particulier avec des sous-marins diesel-électriques comme les classes Sōryū et Taigei, répond aux besoins actuels du Canada. Les forces du Japon en matière de robotique et de systèmes sans pilote – essentielles aux objectifs de « transformation numérique » du Canada en vertu de la stratégie NNFL – peuvent réduire les fardeaux opérationnels grâce à des plateformes améliorées par l’IA, comme les navires sous-marins sans pilote et les navires de surface sans pilote.
En ce qui concerne les communications et la connaissance de la situation, les systèmes satellites et radars avancés du Japon pourraient améliorer les réseaux de capteurs nordiques du Canada. Bien que le Canada se soit associé à l’Australie pour mettre en place des systèmes radar transhorizon, les technologies japonaises peuvent ajouter une redondance précieuse dans des environnements imprévisibles.
Les secteurs de la défense du Japon et de la Corée du Sud ont besoin des minéraux critiques du Canada
En échange de technologies de défense, le Canada offre au Japon et à la Corée du Sud une source stable et démocratique de minéraux critiques, essentiels pour des applications de défense comme les munitions guidées de précision et les batteries perfectionnées. Les risques d’une dépendance excessive vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises ont été illustrés de manière frappante par la crise d’approvisionnement en urée de 2021 en Corée du Sud, déclenchée par un arrêt soudain des exportations chinoises, qui a alimenté les craintes que des perturbations similaires ne paralysent la future production de défense.
Les éléments de terres rares, indispensables aux munitions guidées de précision et aux technologies radar, sont particulièrement vulnérables : la Corée du Sud et le Japon importent respectivement plus de 47 % et 60 % de leurs éléments de terres rares de Chine. L’installation de traitement des terres rares de la Saskatchewan et l’usine d’oxyde de scandium de Rio Tinto au Québec positionnent le Canada comme un fournisseur stratégique. Des investissements conjoints dans la transformation et le recyclage des éléments de terres rares pourraient permettre d’intégrer davantage les matières premières du Canada aux capacités de fabrication avancées du Japon et de la Corée du Sud.
Le cobalt, essentiel pour les batteries lithium-ion des ressources militaires et les alliages pour les munitions, présente des risques et des possibilités similaires. Comme les entreprises chinoises contrôlent 80 % de la production de cobalt au Congo-Kinshasa (d’où provient plus de la moitié du cobalt mondial), les vulnérabilités de l’offre demeurent graves. En tant que quatrième producteur mondial de cobalt, le Canada offre une solution de rechange stable et durable. Des projets comme NICO de Fortune Minerals dans les Territoires du Nord-Ouest et Electra Battery Materials en Ontario peuvent soutenir une chaîne d’approvisionnement trilatérale reliant les ressources canadiennes aux secteurs de défense japonais et sud-coréen.
Les protocoles d’entente bilatéraux existants signés entre le Canada et la Corée du Sud et les protocoles de coopération signés entre le Canada et le Japon, initialement axés sur les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques et des batteries, pourraient être étendus à la production de défense.
Surmonter les difficultés de la coopération trilatérale dans l’Arctique
Le Canada, le Japon et la Corée du Sud partagent une préoccupation commune : leurs liens économiques avec la Chine et leurs partenariats en matière de sécurité avec les États-Unis sont de plus en plus incertains. Que ce soit par la contrainte économique de Beijing ou la diplomatie transactionnelle de Washington, les vulnérabilités de ces dépendances structurelles sont devenues graves. La diversification et l’autonomie stratégique sont désormais impératives. Cette situation fait du trio Canada-Japon-Corée un partenariat axé sur les enjeux particulièrement viable.
En s’assurant des intrants en amont nécessaires aux technologies de défense (les minéraux critiques) et en améliorant les applications en aval (les plateformes et systèmes de défense), les trois pays pourraient construire un écosystème résilient. L’intégration de ces piliers renforce l’ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première à la capacité déployée, maximisant ainsi l’autonomie stratégique et réduisant au minimum l’exposition externe dans l’environnement géopolitique instable d’aujourd’hui.
La création d’un groupe de travail trilatéral composé de hauts fonctionnaires, de chefs de file de l’industrie et de conseillers stratégiques devrait être une priorité absolue. Ce groupe de travail harmoniserait les règles d’investissement, déterminerait les domaines prioritaires et piloterait des projets conjoints, créant un canal structuré pour un dialogue continu et la résolution des conflits.
La participation des peuples autochtones, en particulier dans les régions arctiques du Canada, comme le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, où de nombreux gisements minéraux critiques se trouvent sur des terres autochtones protégées par la Constitution, sera un facteur essentiel. Toute coopération qui ignore les droits des Autochtones risque à la fois des contestations judiciaires et des atteintes à la réputation.
Pour y remédier, le cadre trilatéral doit donner la priorité à l’inclusion des Autochtones en tant qu’élément fondamental, et non après coup. Des ententes de partage des avantages devraient être conclues pour faire en sorte que les communautés autochtones bénéficient de gains directs provenant de l’exploitation des ressources, grâce à des possibilités d’emploi et à des investissements dans l’infrastructure. Les modèles de copropriété, comme les partenariats en actions, peuvent fournir aux groupes autochtones un pouvoir décisionnel significatif dans le cadre de projets de minéraux critiques. Officialiser la diplomatie autochtone en incluant des représentants autochtones dans les discussions trilatérales les reconnaîtrait comme des partenaires souverains dans la gouvernance arctique.
Enfin, les pressions géopolitiques des États-Unis doivent également être gérées avec soin. Même si ce cadre trilatéral vise à compléter, et non à remplacer, les alliances existantes, Washington pourrait percevoir une coopération plus étroite entre le Canada et l’Asie du Nord-Est comme une dilution des engagements du NORAD ou une atteinte à l’ordre de sécurité dirigé par les États-Unis. De même, comme la Chine a déjà mené ses propres discussions trilatérales sur l’Arctique avec le Japon et la Corée du Sud, elle pourrait considérer une initiative trilatérale Canada-Japon-Corée comme une concurrence et lancer des représailles contre les industries canadiennes, japonaises et sud-coréennes.
Pour atténuer ces risques avec les États-Unis et la Chine, la coopération trilatérale Canada-Japon-Corée devrait être explicitement définie comme une stratégie de diversification pragmatique, et non comme une solution de rechange aux alliances existantes. La communication stratégique est essentielle : des réunions d’information diplomatiques ciblées, en particulier avec les homologues américains, pourraient clarifier les intentions et renforcer les engagements à l’égard des partenariats actuels. Les messages publics, y compris dans les médias, doivent mettre l’accent sur la nature précise de la collaboration. L’engagement interentreprises (second niveau) pourrait souligner davantage les objectifs pratiques et non menaçants du partenariat.