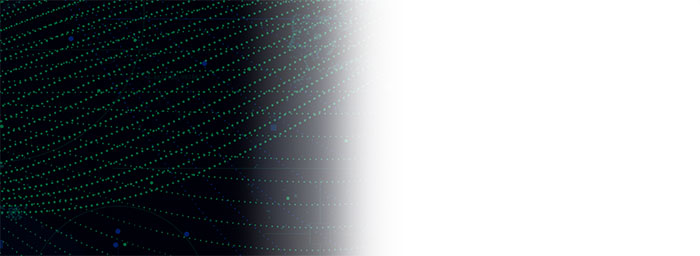Remarque préliminaire de Michael Byers, codirecteur de l’Outer Space Institute, et de Hema Nadarajah, gestionnaire de programme, Asie du Sud-Est, FAP Canada

Alors que les activités relatives à l’espace extra-atmosphérique prennent de plus en plus d’importance, la coordination et la coopération internationales deviennent des conditions nécessaires pour assurer la croissance économique, la sécurité, la durabilité et les progrès scientifiques dans ce domaine. Les pays de la région indo-pacifique disposent de capacités technologiques, de cadres réglementaires et de points de vue diplomatiques distincts en ce qui concerne la nouvelle « ère spatiale ». Cette série de Réflexions stratégiques réunit d’éminents spécialistes d’agences spatiales, d’organisations internationales et d’universités pour explorer l’évolution de la gouvernance de l’espace, avec un accent particulier sur la coordination lunaire et l’utilisation des ressources. Abordant les possibilités et les défis que le Canada et l’Asie ont en commun, ces réflexions jettent la lumière sur la façon dont les deux pays peuvent renforcer leur coopération – une coopération qui repose sur une utilisation inclusive et pacifique de l’espace extra-atmosphérique.

Cette série est le résultat d’un partenariat entre l’Outer Space Institute (OSI) et la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), où les deux organisations ont organisé conjointement un atelier sur la coordination lunaire à Singapour en février 2025. L’OSI est un réseau d’éminents spécialistes de l’espace unis par leur détermination à mener des recherches novatrices et transdisciplinaires pour relever les grands défis qui guettent l’utilisation et l’exploration continues de l’espace.
Nos quatre contributions explorent le rôle des organisations internationales, l’évolution des lois internationales, le pouvoir des petits pays ainsi que le positionnement stratégique d’un important pays de l’hémisphère Sud doté de capacités spatiales :
- Steven Freeland se penche sur les risques géopolitiques et juridiques associés à l’extraction des ressources spatiales. Il met en lumière la nécessité d’un multilatéralisme inclusif pour veiller à ce que les ressources spatiales soient régies de façon pacifique, durable et équitable.
- Robin J Frank réfléchit à la façon dont le droit spatial international – qui en est encore à ses débuts – peut évoluer pour s’adapter aux impératifs d’un secteur spatial privé en croissance rapide. Elle examine comment les normes juridiques, le droit souple et les organisations comme le COPUOS et l’UIT peuvent s’adapter aux technologies et aux acteurs en constante évolution.
- Ashna Lazatin décrit la façon dont les petits pays nouvellement dotés de capacités spatiales peuvent façonner la gouvernance lunaire de façon significative. Par l’entremise d’un dialogue inclusif, d’une expertise spécialisée et d’une mobilisation multilatérale, de tels pays peuvent jouer un rôle de catalyseur en élaborant des règles équitables et tournées vers l’avenir de l’exploration lunaire.
-
Kiran Mohan Vazhapully analyse la position unique de l’Inde en ce qui concerne la gouvernance de l’espace – notamment en raison de ses capacités avancées, du leadership dont elle fait preuve dans l’hémisphère Sud et de sa tradition d’autonomie stratégique. Il soutient que l’Inde est bien placée pour promouvoir un cadre juridique international plus inclusif et équilibré.
Ensemble, ces réflexions constituent un examen nuancé et tourné vers l’avenir de la façon dont le Canada et ses partenaires d’Asie peuvent franchir et façonner la prochaine étape de la gouvernance de l’espace.
Steven Freeland : Ressources spatiales

Certains observateurs affirment que l’exploitation minière spatiale, qui est mal réglementée par le droit international, donnera inévitablement lieu à des litiges, et même à des conflits. Selon vous, l’exploitation minière spatiale est-elle destinée à créer des frictions? Ou croyez-vous plutôt que les pays seront en mesure de s’entendre sur de nouvelles règles et de nouvelles normes, au besoin?
On assiste à un regain d’intérêt concernant les possibles avantages liés à l’exploration, à l’exploitation et à l’utilisation futures des ressources naturelles de la Lune et d’autres corps célestes. Bien que ces « activités liées aux ressources spatiales » puissent avoir des retombées, elles s’accompagnent également de risques et de défis importants.
Il s’agit d’un projet ambitieux ayant des répercussions à l’échelle mondiale; un projet qui risque de changer la façon dont nous envisageons l’espace extra-atmosphérique et la place de l’humanité dans le vaste environnement qui nous entoure. Ses répercussions géopolitiques reposent également sur des questions de pouvoir, de concurrence, de prestige et de rivalité et sur la volonté des pays d’être les premiers à entreprendre de telles activités. C’est sans compter que certaines personnes s’attendent à ce que les activités liées aux ressources de l’espace génèrent des retombées financières et commerciales considérables et que les États semblent souhaiter protéger leurs intérêts, ceux de leurs partenaires aux vues similaires et ceux des participants du secteur privé, en particulier ceux qui se trouvent à l’avant-garde du développement technologique. Cette situation est considérée comme un autre exemple de la course à l’espace.
L’histoire démontre que le contrôle des ressources naturelles sur Terre est souvent le point de mire de nombreux conflits. Il est toujours possible, malgré le statut juridique unique de l’espace extra-atmosphérique – soutenu par le principe de « non-appropriation » abordé par le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, l’Accord sur la Lune de 1979 ainsi que la Charte des Nations Unies de 1945 – que l’attrait des ressources spatiales puisse devenir source de tensions, et même pire.
C’est pourquoi la communauté internationale en est venue à reconnaître qu’elle devait élaborer des mécanismes de gouvernance pour veiller à ce que toute future activité liée aux ressources spatiales soit entreprise en toute sécurité, dans un esprit de durabilité et de façon à réduire au minimum les risques de malentendus, d’erreurs de calcul et de conflits. L’ONU reconnaît la nécessité de faire appel à des processus multilatéraux pour répondre à ces préoccupations. De nombreuses questions doivent être prises en compte, en particulier en ce qui concerne le possible modèle juridique qui pourrait convenir à l’exploration, à l’exploitation et à l’utilisation des ressources spatiales.
Nous devrons également examiner attentivement la possibilité d’une « tragédie des biens communs » en ce qui concerne les ressources spatiales, comme c’est actuellement le cas avec le problème croissant des débris spatiaux. Ce qui est véritablement en jeu, c’est l’avenir de l’accès universel de l’homme à l’espace. Toute initiative radicale qui pourrait être prise à ce stade-ci ferait pencher la balance et éroderait les principes enchâssés dans l’idée selon laquelle l’espace constitue un bien commun mondial. Même si les générations futures pourraient grandement profiter des retombées attribuables à une exploitation sécuritaire et durable des ressources spatiales, il existe des risques importants. Ceux-ci doivent être abordés avec la plus grande prudence et de façon rationnelle. La coopération internationale et un large consensus seront absolument nécessaires.
Cette question est trop importante et trop complexe pour être étudiée par un petit nombre d’entreprises privées ou de pays. Il faudra mettre au point des règles claires et adéquates pour protéger les intérêts de tous les intervenants et aborder les problèmes juridiques, techniques, géopolitiques et stratégiques. Les pays devront travailler ensemble pour établir des normes communes, des lignes directrices et des mécanismes pour réglementer les activités liées aux ressources spatiales et assurer le respect des lois internationales.
Autrement dit, si nous voulons réduire au minimum les risques de malentendus, d’erreurs de calcul, ou pire, il faut absolument éviter que des groupes de pays et d’entreprises s’adonnent à de telles activités selon des règles et des normes opérationnelles divergentes. Le système de concertation du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies (COPUOS), qui repose sur le multilatéralisme et le consensus, constitue la meilleure façon de faciliter le dialogue et de promouvoir l’utilisation pacifique et équitable de l’espace extra-atmosphérique, reconnaissant également qu’il existe une atmosphère de concurrence.
Le travail du Groupe de travail sur les aspects juridiques des activités relatives aux ressources spatiales du COPUOS est un volet important de cette démarche. Ouvert, transparent et inclusif, il permet à tous les États membres de contribuer à l’élaboration de cadres de gouvernance appropriés. Une partie de sa mission, adoptée par consensus par tous les États membres, consiste à :
[é]laborer un ensemble de principes de base recommandés pour ces activités, en tenant compte de la nécessité de veiller à ce que celles-ci soient menées conformément au droit international et d’une manière sûre, durable, rationnelle et pacifique (italique ajouté).
Naturellement, le multilatéralisme n’est pas parfait – il s’agit d’un principe hautement politique et souvent lent et frustrant. Or, lorsqu’il est question de possibles activités liées aux ressources spatiales, il s’agit de la façon la plus souhaitable de maximiser les avantages et de réduire les risques au minimum.
Robin J. Frank : Gouvernance mondiale et droit international

Comment le domaine du droit international de l’espace peut-il composer avec l’augmentation du nombre d’acteurs privés et de leurs capacités?
Le droit international est un ensemble de règles et de normes juridiques qui régit les actions des États et d’autres entités juridiquement reconnues comme des acteurs internationaux (principalement des organisations internationales). Bien que les mécanismes pour faire respecter le droit international soient limités, les États adhèrent majoritairement au droit international, souvent par intérêt personnel éclairé.
Le droit de l’espace en est à ses balbutiements. La nécessité de mettre au point une législation spatiale a été soulevée pour la première fois lorsque l’Union soviétique a lancé le premier satellite artificiel (Sputnik) en 1957, sans que les pays puissent s’opposer à ce qu’il survole leur territoire. C’est cette initiative – et la réaction à celle-ci –, ainsi qu’une résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1963, qui ont permis d’établir que l’espace est libre d’exploration et d’utilisation par tous les États et toute l’humanité et ne peut faire l’objet d’aucune appropriation nationale.
Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique était à l’origine motivé par le désir d’assurer une exploration pacifique de l’espace et d’éviter la multiplication des armes nucléaires dans l’orbite terrestre. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 est la Grande Charte du droit de l’espace. Négocié sous l’égide du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) des Nations Unies, le Traité sur l’espace extra-atmosphérique établit des principes fondamentaux, notamment que toutes les activités spatiales doivent être réalisées à des fins pacifiques et qu’aucun pays ne peut revendiquer la souveraineté sur l’espace extra-atmosphérique (y compris la Lune et les autres corps célestes). Le droit de l’espace multilatéral comprend également plusieurs autres traités négociés avec l’aide du COPUOS, comme la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux de 1972 et des instruments non contraignants, comme les Lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales, adoptées par le COPUOS en 2021. (Les instruments non contraignants sont des accords entre États qui ne créent pas d’obligations juridiques contraignantes, mais servent plutôt à établir des normes, à encourager la coopération et à fournir un cadre pour aborder les défis mondiaux de plus en plus complexes, sans la rigueur juridique des traités, par exemple.)
Une autre agence spécialisée de l’ONU a également adopté des normes contraignantes, sous la forme de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Sa constitution (notamment l’article 44), sa convention et son règlement sur les radiocommunications comprennent des éléments importants qui réglementent les activités spatiales, en particulier l’utilisation du spectre radio – l’éventail limité des fréquences électromagnétiques utilisées pour les signaux de communication – et les créneaux orbitaux (emplacement) des satellites dans l’orbite terrestre, en particulier dans la ceinture géostationnaire, pour éviter les interférences. Les membres de l’UIT créent également des instruments non contraignants, comme des résolutions et des recommandations.
Acteurs dans l’espace et dans les organisations d’exploration de l’espace
Pendant les vingt premières années de l’exploration spatiale, l’espace était le terrain de jeu exclusif des acteurs étatiques. Or, à compter des années 1980, plusieurs acteurs commerciaux ont commencé à mener des activités dans l’orbite terrestre, y compris le lancement de satellites de communication et de radiodiffusion. Depuis, la tendance est plutôt aux activités spatiales commerciales, que ce soit pour la télédétection, les services de lancement et la navigation par satellite, au fret commercial, aux vols spatiaux habités et au tourisme spatial. L’espace est maintenant considéré comme une puissance financière qui a vu naître de nombreuses nouvelles technologies dont nous sommes maintenant tributaires. Pour les États-Unis, le système GPS a généré des retombées économiques d’environ 1,4 billion $ US entre les années 1980 (lorsque son utilisation aux fins civiles et commerciales a été approuvée) et 2017. Les satellites commerciaux sont maintenant essentiels pour les transactions financières internationales et nationales, les prévisions météorologiques, les activités agricoles, l’aide en cas de catastrophe et, dans de nombreuses régions, l’accès à Internet. Selon certaines sources, le marché de l’espace aurait généré plus de 800 billions $ US. En 2025, plus de 250 lancements orbitaux auraient été réalisés. À cet égard, il est essentiel de souligner que les gouvernements ne sont pas les seuls créateurs du droit international – l’industrie y joue aussi un rôle important. Par exemple, les origines du droit international moderne – qui est lié au droit de la mer – ont vu le jour grâce à l’œuvre Mare Liberum de Hugo Grotius, parue en 1609, qui avait été commandée par des intérêts privés néerlandais.
Le COPUOS est composé d’un comité et de sous-comités auxquels siègent les États membres ainsi que des organisations spécialisées qui agissent comme observateurs, avec l’autorisation des États membres. L’UIT, quant à elle, permet aux joueurs du secteur privé, aux entités scientifiques et aux entités non gouvernementales de contribuer directement aux processus, y compris aux études et aux négociations concernant la réglementation du spectre et des orbites – même si les décisions définitives (p. ex. modifier le règlement sur les radiocommunications) reviennent aux gouvernements et sont principalement prises par consensus. L’UIT et le COPUOS permettent tous deux aux États de faire appel à des représentants du secteur privé dans leurs délégations nationales, et ces représentants peuvent prendre la parole, à la discrétion de la délégation, et prendre part à la majorité des travaux de moindre mesure (mais tout de même très importants).
L’espace est de plus en plus litigieux, encombré et achalandé. Les États reconnaîtront-ils que les avantages économiques de la coopération dans l’espace l’emportent sur les avantages militaires? Le marché peut-il réguler le secteur privé sans faire appel à plus de lois internationales? La plupart des entreprises privées veulent d’une réglementation pour uniformiser les règles du jeu et offrir de la stabilité. Les progrès technologiques sont à l’origine du droit de l’espace; on peut espérer que son développement se poursuivra à un rythme soutenu. Dans le meilleur des modes, le droit de l’espace continuera de se développer par l’entremise d’une coopération entre les États et le secteur, de la diplomatie, de lignes directrices internationales, d’autres formes de normalisation et de traités multilatéraux, régionaux et bilatéraux.
Ashna Lazatin: Acteurs émergents dans le domaine spatial

Dans quelle mesure les petits pays et les pays émergents dotés de capacités spatiales devraient-ils contribuer au développement de la gouvernance des activités lunaires?
Les activités lunaires englobent un large éventail de possibilités qui vont au-delà des activités circumterrestres classiques, comme l’exploration, les activités scientifiques et de recherche, l’extraction et l’utilisation des ressources, le développement des infrastructures, la gestion de la circulation spatiale – à la surface de la Lune comme en orbite lunaire –, la réduction des débris spatiaux et même l’habitation humaine. Chacune de ces possibilités se trouve à un stade de développement différent, et le degré d’engagement varie considérablement d’un acteur international à l’autre, qu’il s’agisse d’États, d’entreprises privées ou d’universités.
Les États qui disposent de programmes spatiaux plus établis ont accès à davantage de ressources, à une meilleure expertise technique et à une plus grande volonté politique pour repousser les limites de l’exploration lunaire. Cela ne signifie toutefois pas que les petits pays et les pays émergents dotés de capacités spatiales doivent rester en marge alors que l’humanité s’apprête à effectuer un autre grand pas sur la Lune.
Les petits pays et les pays émergents peuvent jouer plusieurs rôles essentiels pour façonner la gouvernance des activités lunaires. Premièrement, dans un esprit d’inclusion, ils peuvent présenter les points de vue des acteurs émergents du domaine spatial aux côtés de ceux des grandes puissances sur les plateformes internationales. Ces États peuvent aider à ouvrir la voie à un dialogue ouvert, à un accès équitable, à un renforcement des capacités et à l’élaboration de processus égalitaires qui tiennent compte des intérêts de tous.
Deuxièmement, malgré leurs ressources limitées, les petits pays et les pays émergents pourraient devenir de petits fournisseurs spécialisés dans plusieurs domaines d’intérêt. Par exemple, un petit pays pourrait se spécialiser dans une technologie particulière indispensable aux activités lunaires, comme les communications avancées, la navigation et la surveillance environnementale. D’autres pourraient exercer un leadership éclairé sur le plan des politiques lunaires ou de la loi sur la Lune, notamment en mettant au point des cadres juridiques novateurs ou des énoncés de politiques qui aident à façonner des règles justes et tournées vers l’avenir en ce qui concerne la gouvernance lunaire. En investissant dans ces secteurs spécialisés, les petits pays et les pays émergents peuvent prouver leur pertinence stratégique et enrichir la capacité collective de la communauté internationale à régir les activités lunaires en toute efficacité et équité.
Troisièmement, ces pays doivent s’efforcer de devenir des collaborateurs proactifs sur les plateformes pertinentes, notamment en facilitant la coopération et le dialogue multilatéraux entre les divers acteurs internationaux. Il pourrait s’agir, par exemple, du Groupe de travail sur les aspects juridiques des activités liées à l’espace du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) des Nations Unies, l’équipe d’action sur la consultation sur les activités lunaires (ATLAC) du COPUOS ou des initiatives lunaires régionales ou nationales, comme les accords Artemis et la station de recherche lunaire internationale. Ce rôle est essentiel pour les questions complexes comme les normes de gestion et de gouvernance des ressources, pour lesquelles des solutions collaboratives permettraient de répondre aux préoccupations collectives.
À mesure que les activités lunaires s’intensifient, les petits pays et les pays émergents dotés de capacités spatiales auront le droit et la responsabilité de façonner les règles du jeu. En présentant divers points de vue, en devenant des fournisseurs spécialisés et en agissant comme des collaborateurs proactifs, ils peuvent contribuer à faire en sorte que la gouvernance lunaire demeure inclusive, équitable et attentive aux besoins de l’humanité – des facteurs essentiels pour bâtir un avenir durable et pacifique sur la Lune.
Kiran Mohan Vazhapully : Acteurs asiatiques dans le domaine spatial

Comment l’Inde peut-elle contribuer à l’élaboration du droit international de l’espace?
Grâce à ses capacités spatiales avancées qu’elle a veillé à développer au cours des 70 dernières années, l’Inde s’est fermement implantée dans le domaine spatial. Son économie spatiale devrait atteindre 44 milliards $ US d’ici 2035. Son statut de pays en développement et la ferveur avec laquelle elle défend depuis longtemps les pays en développement sur l’échiquier de la gouvernance mondiale font d’elle un partenaire incontournable pour promouvoir un droit spatial international inclusif et équitable.
La philosophie de non-alignement et l’autonomie stratégique de l’Inde lui procurent une excellente base pour faire preuve de leadership sur le plan du droit spatial. Aux côtés du Chili et de l’Égypte, le pays a ardemment plaidé en faveur d’un accès équitable dans le cadre des négociations qui ont abouti au Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 et n’a ménagé aucun effort pour intégrer le principe de l’« héritage commun de l’humanité » dans l’Accord sur la Lune lors des négociations qui se sont déroulées entre 1971 et 1979. La politique spatiale indienne de 2023 reflète cette position de principe et l’engagement de New Delhi à l’égard de la coopération internationale, sans toutefois amoindrir l’autonomie stratégique du pays. L’Inde a signé des accords de coopération dans le domaine de l’espace avec 61 pays et 5 organismes multilatéraux, accords qui se concentrent principalement sur la télédétection par satellite, la navigation, les communications, la science spatiale et le renforcement des capacités.
Autonomie stratégique et coopération technologique
L’Inde demeure profondément sceptique à l’égard des normes internationales qui ont été élaborées sans sa participation significative et qui semblent dominées par de grands enjeux de pouvoir. Cette position repose sur son identité historique et un principe d’autonomie stratégique qui a évolué au fil du temps. Le pays hésite à adhérer à des instruments politiques non contraignants qu’il perçoit comme restrictifs. Par exemple, l’Inde s’est abstenue en 2022 de voter sur une résolution des Nations Unies (dirigée par les États-Unis) visant à interdire les essais au sol de missiles antisatellite générant des débris. Elle s’est également abstenue de voter en 2024 sur une résolution visant à réduire les menaces spatiales par l’entremise de normes comportementales.
Dans les discussions sur la sécurité, l’Inde s’est toujours plutôt rangée du côté de la Chine que des États-Unis et préfère les accords juridiquement contraignants aux normes volontaires axées sur le comportement. New Delhi a toujours soutenu la négociation d’un traité contraignant concernant la prévention d’une course aux armements dans l’espace. Ce point de vue provient du fait que les normes volontaires peuvent être subjectives, et donc qu’elles peuvent être utilisées pour interpréter injustement les menaces, tandis que les instruments juridiquement contraignants offrent une plus grande clarté et une meilleure équité.
L’Inde encadre activement les technologies spatiales et considère la coopération comme un outil pertinent pour favoriser le développement régional et mondial. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne l’engagement de l’Inde avec l’hémisphère Sud. Le satellite GSAT-9, lancé en 2017, est un bel exemple de la façon dont le pays utilise activement la technologie spatiale comme instrument de politique étrangère. Le GSAT-9 fournit maintenant des biens publics, comme des services de télé-éducation et de gestion des catastrophes, aux pays voisins. Ce modèle de projets spatiaux collaboratifs constitue un puissant outil diplomatique qui stimule la collaboration régionale de façon proactive.
Lors du sommet du G20 de 2023, l’Inde a proposé de lancer un « satellite du G20 pour observer l’environnement et le climat » en vue de partager des données climatiques et météorologiques avec tous les pays, en particulier ceux du Sud. La démocratisation de l’accès à l’espace est un pilier de la diplomatie spatiale de l’Inde. Pour terminer, l’Inde est devenue un partenaire intéressant pour les pays en développement qui cherchent à bâtir leur propre infrastructure spatiale, en leur offrant des services de lancement fiables et économiques.
La combinaison unique de capacités spatiales, de patrimoine diplomatique et de plaidoyer à l’égard de l’hémisphère Sud de l’Inde aidera le pays à redéfinir en profondeur le droit spatial international. Le pays devrait chercher à tirer parti de sa philosophie de non-alignement et de son engagement à l’endroit du multilatéralisme inclusif d’une manière plus proactive, en plus de veiller à ce que la gouvernance de l’espace réponde aux intérêts collectifs de l’humanité au lieu de maintenir les déséquilibres de pouvoir existants. Le pays devrait également participer davantage aux forums multilatéraux, envisager une utilisation stratégique des initiatives diplomatiques liées à l’espace et adhérer fermement au principe selon lequel l’exploration spatiale devrait se faire dans l’intérêt de tous les pays, indépendamment de leurs capacités technologiques. Pour terminer, l’approche de l’Inde devrait prendre racine dans les valeurs d’inclusion et de confiance de la doctrine d’Inder Kumar Gujral, la feuille de route à cinq points qui oriente les relations régionales de l’Inde, pour veiller à ce que ses engagements relatifs au domaine spatial favorisent une véritable solidarité régionale et des progrès communs.