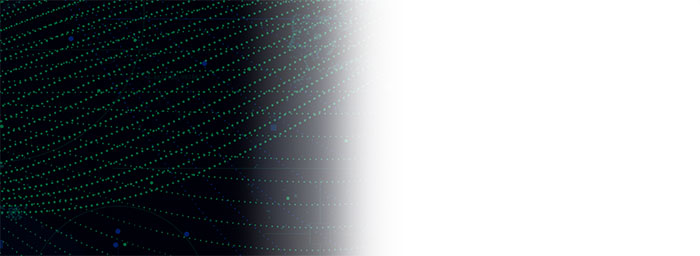Le 11 septembre 2025, la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), en partenariat avec le Bureau économique et culturel de Taïwan (TECO) à Canada, l’ambassade de Lituanie et l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Ottawa, a organisé une table ronde Résilience démocratique et sécurité maritime : protéger les câbles sous-marins et l’infrastructure numérique. L’événement organisé à Ottawa a réuni des ambassadeurs, des décideurs politiques, des experts en matière de défense, des représentants du secteur et des leaders de la société civile pour examiner l’une des vulnérabilités les plus urgentes, mais souvent négligées, de notre monde interconnecté : la protection des câbles sous-marins et de l’infrastructure numérique critique.
Bien que les câbles sous-marins acheminent 95 % du trafic numérique mondial, y compris des billions de dollars en transactions financières et des communications gouvernementales délicates, ils restent vulnérables aux catastrophes naturelles, au sabotage et aux tactiques de guerre hybrides délibérées. Comme l’a fait remarquer Vina Nadjibulla, vice-présidente, Recherche et stratégie de la FAP Canada, ces infrastructures, qui étaient « loin des yeux, loin du cœur » il y a quelques années à peine, sont maintenant devenues des atouts de premier plan dans la lutte pour préserver la résilience de la démocratie.
Ce rapport résume les points importants de la discussion.
Importance des câbles sous-marins
Dans son introduction, Mme Nadjibulla a souligné que les câbles sous-marins (les artères numériques de l’économie moderne) sont devenus à la fois indispensables et très vulnérables. Non seulement ils permettent les communications quotidiennes, mais ils sous-tendent également 10 000 milliards $ US de transactions financières quotidiennes, d’opérations militaires et de services gouvernementaux. L’importance de la concentration des câbles et leur vulnérabilité au sabotage dans des points névralgiques comme la mer Baltique, le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale en font des cibles attrayantes pour les États adversaires et les acteurs non étatiques.
Elle a souligné trois thèmes pour encadrer la discussion :
1. Partenariats public-privé : La majorité des infrastructures étant privées, les gouvernements ne peuvent pas les sécuriser eux-mêmes.
2. Solidarité démocratique : Les démocraties doivent se coordonner pour répondre aux menaces hybrides, surtout si l’on considère les preuves de la coopération entre la Russie et la Chine dans le domaine maritime.
3. Rôle de « pont » du Canada : Situé entre les régions euro-atlantique et indo-pacifique, le Canada est particulièrement bien placé pour favoriser le dialogue et l’action entre les régions.
Vulnérabilités dans la mer Baltique
L’ambassadeur lituanien Egidijus Meilūnas a dressé un bilan sévère de la région de la mer Baltique, qui a été la cible d’agressions russes. Il a fait remarquer que la mer Baltique est peu profonde (en moyenne, seulement 54 mètres), ce qui rend les câbles beaucoup plus accessibles au sabotage que dans l’océan Atlantique, où les profondeurs dépassent les 6 000 mètres. En même temps, elle est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, avec 4 000 navires qui y transitent chaque jour, ce qui intensifie le risque d’accidents et d’interférences délibérées.
L’ambassadeur Meilūnas a détaillé quatre incidents de sabotage majeurs entre fin 2023 et 2024, dont la rupture de l’oléoduc connecteur de la Baltique et la coupure de plusieurs câbles de données reliant la Finlande, l’Estonie et la Suède. Dans plusieurs cas, des navires battant pavillon chinois, comme le NewNew Polar Bear, et des cargos russes de la « flotte fantôme » étaient présents sur les sites des dommages. Bien que les enquêtes d’attribution ne soient pas encore concluantes, il a déclaré que les schémas indiquent clairement des opérations hybrides liées à l’État.
La Lituanie a réagi en prenant des mesures à trois volets :
1. À l’échelle nationale : Nouvelle législation criminalisant le sabotage et codifiant les protocoles d’intervention rapide au moyen de son centre national de gestion des crises.
2. À l’échelle régionale : Coopération renforcée par le Conseil des États de la mer Baltique (dont la Russie a été exclue après son invasion de l’Ukraine en 2022).
3. À l’échelle internationale : Participation au réseau d’infrastructures sous-marines critiques de l’OTAN et création d’un centre maritime de l’OTAN dédié à la sécurité des câbles.
L’ambassadeur Meilūnas a conclu en soulignant deux impératifs clairs : les démocraties doivent établir des limites pour dissuader les agresseurs, et elles doivent accroître leur soutien à l’Ukraine, qu’il a décrite comme « se battant non seulement pour elle-même, mais aussi pour la sécurité de toute l’Europe ». Il a ajouté que la sécurité transatlantique est étroitement liée à celle de l’Indo-Pacifique, d’où la nécessité de renforcer le soutien à Taïwan.
Le détroit de Taïwan assiégé
M. Harry Tseng, Ph. D., représentant du TECO, a redirigé l’attention vers l’Indo-Pacifique, où la dépendance de Taïwan à l’égard des câbles sous-marins est tout à fait essentielle. Avec 24 câbles (14 internationaux et 10 nationaux) qui transportent 99 % de sa bande passante, Taïwan serait confrontée à des perturbations catastrophiques si ces câbles étaient rompus. Une étude estime que la perte économique quotidienne serait de 3,1 milliards $ US si toutes les liaisons internationales étaient désactivées.
M. Tseng a détaillé plusieurs tentatives récentes de sabotage par des navires « sous pavillon de complaisance », c’est-à-dire des navires immatriculés dans des territoires faibles, mais liés à des entités chinoises. En voici quelques exemples :
- Le Xing Shun 39, soupçonné d’avoir endommagé le câble Trans-Pacific Express entre Taïwan et les États-Unis après avoir flâné dans les eaux taïwanaises alors que son système d’identification automatique était désactivé.
- Le Bao Shun, un navire immatriculé en Mongolie qui a circulé à plusieurs reprises autour des zones de câbles de Taïwan malgré les avertissements de la garde côtière taïwanaise.
-
Le Hong Tai 58, battant pavillon togolais, qui a délibérément jeté son ancre en travers d’un câble, ce qui a donné lieu aux premières poursuites judiciaires réussies de Taïwan pour sabotage de câble. Le capitaine a été condamné à trois ans de prison.
M. Tseng a également souligné que ces activités font partie de la tactique de la zone grise de la Chine, qui vise à tester la tolérance internationale et à normaliser progressivement un comportement coercitif sans déclencher une guerre ouverte. Il a présenté les contre-mesures de Taïwan :
1. Surveillance active : Liste noire de 96 navires suspects, soutenue par des véhicules aériens sans pilote et des véhicules de surface sans pilote pour la surveillance.
2. Intervention intégrée : Renforcement de la coordination entre la marine et la garde côtière et des systèmes de signalement rapide reliant les procureurs et les forces de l’ordre.
3. Renforcement de la résilience : Investissements dans des satellites en orbite basse pour diversifier la connectivité.
4. Coopération internationale : Collaboration avec les alliés démocratiques pour détecter les navires clandestins près des eaux taïwanaises.
« Les attaques contre les câbles à Taïwan et dans la mer Baltique peuvent sembler lointaines, a averti M. Tseng, mais ce qui se passe sous la mer aujourd’hui pourrait menacer toutes les démocraties demain. »
Construire des défenses juridiques et technologiques
L’ambassadrice adjointe de l’Allemagne, Karina Häuslmeier, a présenté l’enjeu dans le contexte plus large de la sécurité en Europe, où la guerre de la Russie en Ukraine et les incursions de drones en Pologne soulignent la frontière floue entre la guerre et la paix. « Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes certainement pas en paix. »
L’Allemagne, a-t-elle expliqué, vient d’adopter une nouvelle législation sur les infrastructures critiques obligeant les opérateurs à élaborer des plans de résilience contre le sabotage, mettant ainsi en œuvre la directive de l’UE sur la résilience des entités critiques. À l’échelle européenne, le plan d’action 2024 de l’UE pour les câbles sous-marins se concentre sur la prévention, la détection, l’intervention et la dissuasion, avec des investissements majeurs dans la cybersécurité et la surveillance maritime.
Mme Häuslmeier a souligné l’importance du sommet de la mer Baltique qui s’est tenu à Helsinki à l’échelle de l’OTAN et de l’extension de la présence maritime de l’Alliance. L’OTAN déploie désormais des drones sous-marins, l’intelligence artificielle et des outils de connaissance de la situation pour prévenir les actes de sabotage de manière proactive. L’Allemagne est également engagée dans des initiatives bilatérales et du G7, notamment la déclaration du G7 de 2025 sur la sécurité et la prospérité maritimes.
Mme Häuslmeier a reconnu qu’en dépit des progrès accomplis, des défis subsistent, notamment des lacunes juridictionnelles entre les autorités civiles, militaires et de renseignement, des difficultés dans le partage de l’information et la nécessité de mieux intégrer les opérateurs du secteur privé. Elle a néanmoins réaffirmé l’engagement de l’Allemagne à faire progresser la résilience grâce à l’innovation et à la coopération entre alliés.
Thèmes et conclusions
Lors de la discussion dirigée, un participant a souligné l’importance de l’attribution. En l’absence de preuves claires établissant un lien entre le sabotage et les acteurs étatiques, la dissuasion et les options de réponse restent limitées. Le participant a soulevé une question pertinente : les perturbations des câbles commises par la Chine sont-elles des « missions de reconnaissance ou des répétitions » en vue d’opérations plus importantes, comme un blocus ou une invasion de Taïwan? Un autre participant a souligné l’utilisation par le Royaume-Uni de sa loi sur la sécurité nationale de 2023 pour engager des poursuites à la suite d’attaques hybrides, dont un incendie criminel à Londres dirigé par la Russie. Il a suggéré que le partage des innovations législatives pourrait renforcer la dissuasion collective contre le sabotage parrainé par l’État. Un commentaire a également indiqué la nécessité d’une collaboration plus étroite entre les secteurs public et privé, car les exploitants de câbles et les entreprises du secteur de l’énergie détectent souvent les incidents avant les gouvernements. Toutefois, les défis liés au partage de l’information et aux cadres de responsabilité ont également été relevés.
Plusieurs autres thèmes transversaux ont émergé de la discussion :
1. La guerre hybride comme arme psychologique
Au-delà de son incidence physique, le sabotage des câbles sous-marins vise à semer l’insécurité, à saper la confiance dans les institutions et à démontrer la vulnérabilité des démocraties.
2. Attribution et responsabilité
La difficulté d’attribuer les actes de sabotage nuit à la dissuasion. Les participants ont souligné la nécessité de normes plus claires en matière de preuves, d’enquêtes conjointes et d’une volonté politique d’attribuer les responsabilités.
3. Innovation juridique
De la criminalisation du sabotage par la Lituanie à la loi allemande sur les infrastructures, en passant par les poursuites historiques engagées par Taïwan, l’adaptation de la législation devient un moyen de défense de premier plan.
4. Partenariats public-privé
La plupart des câbles étant détenus par des entités privées, les gouvernements doivent encourager la coopération, investir dans la redondance et inclure le secteur dans la planification et les exercices.
5. Liens transrégionaux
La sécurité dans les régions euro-atlantique et indo-pacifique est étroitement liée. La Russie et la Chine coordonnent leurs stratégies; les démocraties doivent faire de même. Le Canada, qui relie les deux régions, a un rôle unique à jouer.
6. Technologie et innovation
Les outils de surveillance, comme la surveillance assistée par l’IA, les drones et la détection des navires clandestins, offrent des moyens rentables de renforcer la connaissance du domaine maritime.
La table ronde a souligné que les câbles sous-marins constituent des infrastructures numériques vitales pour les démocraties. Leur protection ne relève pas d’un enjeu technique marginal, mais d’un pilier central de la sécurité nationale, de la stabilité économique et de la résilience démocratique. Ce dossier touche à de nombreux autres enjeux, et le Canada joue un rôle stratégique en tant qu’acteur à la fois de l’Indo-Pacifique, de l’Atlantique et de l’Arctique.
Les conférenciers de Lituanie, de Taïwan et d’Allemagne ont souligné que les États autoritaires ciblent de plus en plus cette infrastructure pour déstabiliser les démocraties, mettre à l’épreuve la détermination internationale et faire avancer leurs objectifs stratégiques. Le Canada et ses alliés doivent réagir en combinant l’innovation juridique, l’investissement technologique, la coopération internationale et, surtout, la solidarité.
Comme l’a fait remarquer M. Tseng dans ses conclusions, « couper les communications est une forme de guerre hybride. Bien qu’elle ne soit pas une guerre à grande échelle, elle peut en être un prélude redoutable ». Plus les démocraties se préparent ensemble, moins elles seront vulnérables à de telles tactiques coercitives. Cette table ronde, qui a fait le lien entre les régions euro-atlantique et indo-pacifique, représente une étape cruciale vers cette préparation collective.