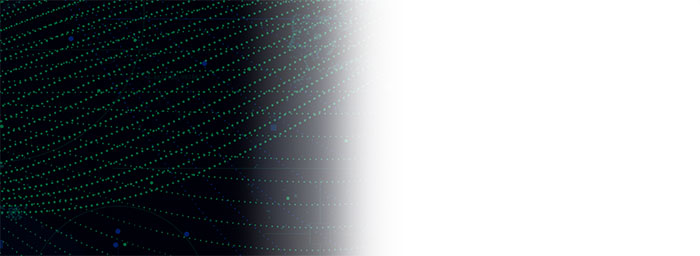Le 15 septembre 2025, la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a tenu une table ronde sur « La coopération Canada-ANASE à un point tournant : priorités durant les années de présidence malaisienne et philippine » à son bureau de Vancouver. À cette occasion, il a été question de l’engagement du Canada envers l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), qui comprend 10 membres, bientôt 11 avec l’ajout du Timor-Leste. L’événement a réuni trois universitaires de premier plan pour examiner les occasions, les difficultés et les zones de coopération possibles qui façonneront l’avenir des relations Canada-ANASE, en particulier celles avec la Malaisie et les Philippines, pays respectivement actuel et à venir à la présidence de l’ANASE.
Collectivement troisième pour la population et cinquième pour l’économie, l’ANASE dans son ensemble est centrale aux démarches canadiennes visant à diversifier son portefeuille de commerce et d’investissement. En 2023, le Canada et l’ANASE ont fait passer leur partenariat au niveau stratégique, Ottawa s’affairant maintenant à conclure un Accord de libre-échange ANASE-Canada et un Plan d’action quinquennal révisé d’ici la fin 2025.
Vu le mouvement mondial vers le protectionnisme économique et le nationalisme, et la nécessité pour Ottawa de diversifier son portefeuille de commerce et d’investissement au-delà des États-Unis, il est crucial pour le Canada d’élargir ses engagements envers l’ANASE. Ce nouveau sentiment d’urgence évolue sur un fond géopolitique complexe, l’Asie du Sud-Est se trouvant au premier rang de la concurrence stratégique grandissante entre les États-Unis et la Chine, en plus d’être le site de plusieurs points chauds.
Le présent rapport résume les faits saillants de la discussion.
Conférenciers :
- Richard Heydarian, maître de conférences en affaires internationales au Centre asiatique de l’Université des Philippines et chercheur invité sur l’Indo-Pacifique de la FAP Canada.
- Tricia Yeoh, Ph. D., professeure agrégée de pratique à l’Université de Nottingham en Malaisie et attachée de recherche supérieure à la FAP Canada.
- Kai Ostwald, Ph. D., professeur agrégé à l’École des politiques publiques et des affaires mondiales et au département de sciences politiques de l’Université de la Colombie-Britannique, et attaché de recherche supérieur à la FAP Canada.
- Vina Nadjibulla, vice-présidente en recherche et stratégie, FAP Canada (modératrice).
Renforcer les liens Canada-ANASE : surmonter les difficultés et saisir les occasions
En lançant la Stratégie Indo-Pacifique canadienne en 2022, le Canada a cherché à accroître et à approfondir de façon considérable son engagement envers l’Asie du Sud-Est. Vina Nadjibulla a souligné que cette région offre un vaste potentiel de marché et des occasions d’affaires émergentes dans l’économie numérique, dont les technologies de pointe comme l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, ainsi que les partenariats relatifs à la sécurité.
L’ANASE arrive maintenant au quatrième rang des partenaires commerciaux du Canada, le commerce bilatéral de marchandises s’élevant à 42,3 milliards $ CA en 2024. Au-delà du commerce, le Canada a accru sa présence sur le terrain dans la région de façon importante en ouvrant des bureaux d’expansion des exportations en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam, un bureau de l’agriculture et de la sécurité alimentaire aux Philippines et un institut de la finance du développement à Singapour, depuis 2023. En outre, l’engagement ministériel s’est renforcé, notamment par des visites inaugurales du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères canadiens aux sommets annuels de l’ANASE.
Néanmoins, même si Ottawa s’efforce de finaliser l’Accord de libre-échange ANASE-Canada attendu depuis longtemps et de mettre à jour son plan d’action sur l’ANASE, le Canada doit confronter sa réputation d’« ami des beaux jours » manquant encore de constance et de fiabilité, qualités appréciées de ses partenaires de l’Asie du Sud-Est. Les participants ont souligné des difficultés importantes, notamment celle de dépasser le commerce pour prouver la volonté de coopérer dans des domaines concordant avec les priorités de l’ANASE et le soutien continu de la centralité et de la neutralité stratégique de l’ANASE au milieu des tensions géopolitiques, dont la rivalité grandissante entre les États-Unis et la Chine.
Cela dit, le Canada n’est pas sans ses avantages. Le pays est toujours vu comme un robuste partisan de la gouvernance démocratique et des normes libérales, comme l’illustre son rôle constructif en soutien à la démocratisation du Myanmar ces dernières années. De plus, le Canada héberge l’une des diasporas de l’Asie du Sud-Est en plus forte croissance à l’extérieur de la région, ce qui renforce encore davantage les relations interpersonnelles et les liens culturels.
De surcroît, dans le « vide de leadership » laissé par la deuxième administration du président Trump aux États-Unis et sa politique commerciale étrangère, les États de l’ANASE cherchent activement des partenaires fiables aux points de vue similaires, a noté M. Kai Ostwald. Ce paysage en évolution offre au Canada une occasion de jouer un rôle plus important dans la définition de la coopération régionale.
Ces occasions seront encore plus d’actualité lorsque la présidence de l’ANASE passera aux Philippines en 2026. Comme l’a souligné Richard Heydarian, on s’attend à ce que Manille place la sécurité maritime en tête de son agenda, notamment les différends sur la mer de Chine méridionale.
Le prochain plan d’action quinquennal du Canada
En ce moment où le Canada s’apprête à revoir son Plan d’action quinquennal pour l’ANASE (2021-2025), tous les conférenciers s’entendent pour dire que sa réussite exigera de dépasser les accords commerciaux.
Richard Heydarian a exhorté le pays à mener des « interventions nichées » susceptibles d’avoir une incidence importante à un faible coût. Il a souligné le programme de détection des navires clandestins, qui a contribué au repérage de navires s’adonnant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. S’appuyant sur ce point, M. Ostwald a indiqué l’expertise canadienne liée aux problèmes de sécurité non traditionnels (comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les crimes transnationaux), où l’aide technique canadienne pourrait faire une bonne différence.
Mme Tricia Yeoh a fait référence à la montée alarmante de la cybercriminalité dans la région, notant que plusieurs États membres de l’ANASE manquent de politiques et de cadres réglementaires efficaces pour rester en phase avec cette menace qui évolue rapidement. Elle a suggéré que le Canada est bien placé pour aider les pays à élaborer des politiques, des règlements et des initiatives de renforcement des capacités plus robustes. Vina Nadjibulla a ajouté que la coopération Canada-ANASE progresse déjà dans ce domaine, citant le lancement du BlackBerry Cybersecurity Center of Excellence en Malaisie comme exemple de réussite initiale.
Au-delà de ces domaines de coopération tangibles, Mme Yeoh a insisté sur l’importance des liens interpersonnels, des échanges culturels et du soutien aux normes libérales démocratiques, domaines où le Canada peut aider à combler un vide grandissant laissé par les partenaires occidentaux de plus en plus axés sur la sécurité et la défense.
Étant donné la suspension des programmes de USAID et la politique étrangère des États-Unis, maintenant centrée sur l’intérieur, M. Ostwald a noté que le Canada dispose d’une occasion unique de se positionner comme une « solution de rechange nord-américaine », surtout en enseignement supérieur, en aide au développement et en soutien à la gouvernance démocratique au Myanmar et au-delà.
Le chemin à suivre
Malgré les turbulences en cours, les États de l’ANASE réaffirment toujours leur engagement envers un ordre international fondé sur les règles. M. Ostwald a reconnu que l’engagement du Canada dans la région s’est accru depuis le lancement de la Stratégie, mais a émis un avertissement comme quoi il devait être soutenu et visible.
Au même moment, comme l’a observé Mme Yeoh, l’engagement du Canada demeure très porté sur le commerce, soulignant la nécessité pour Ottawa de prouver que le pays peut être plus qu’un partenaire commercial et se distinguer de ses concurrents comme la Chine, l’Inde et le Japon.
En outre, Richard Heydarian a insisté sur l’importance de la crédibilité, remarquant que certains États de l’Asie du Sud-Est, comme l’Indonésie et la Malaisie, ont critiqué l’application sélective des lois internationales de la part des pays occidentaux, faisant référence aux réponses non uniformes aux conflits comme l’invasion russe en Ukraine en comparaison avec la guerre à Gaza.
Tous les participants s’entendaient pour affirmer qu’il sera crucial pour renforcer la confiance dans la région que les lois internationales et l’ordre international fondé sur des règles soient appliqués de façon égale.