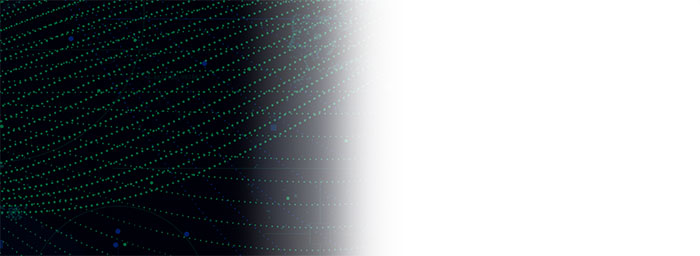La Stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique (SIP) a franchi le cap crucial des trois ans. À date, le bilan est plutôt positif : le Canada est plus présent, plus visible et plus connecté aux réseaux régionaux qu’il ne l’a jamais été de mémoire récente. De nouveaux bureaux ont été ouverts, les déplacements des ministres et des premiers ministres sont devenus habituels, les missions commerciales d’Équipe Canada attirent d’importantes délégations et les Forces armées canadiennes opèrent désormais dans la région à un rythme soutenu.
Il s’agit de changements réels, qui porteront leurs fruits pour la résilience économique et la sécurité du Canada dans la région la plus cruciale du monde. La SIP s’est toutefois aussi heurtée à des contraintes canadiennes attendues – conceptuelles, institutionnelles et de ressources – qui limitent son incidence. Trois ans plus tard, il s’agit de nous assurer que notre présence dans la région indo-pacifique se traduise par des avantages tangibles. Pour ce faire, nous passons d’une longue liste d’activités à un ensemble plus précis d’objectifs, de priorités et de partenariats qui servent les intérêts nationaux du Canada dans un environnement stratégique de plus en plus complexe.
En 2025, le monde est très différent de celui dans lequel le Canada a lancé sa stratégie de 2022. Nous vivons une compétition accélérée entre grandes puissances, une fragmentation économique plus marquée et une intensification des pressions de la zone grise dans le cyberespace, les domaines maritimes et les chaînes d’approvisionnement. Les séquelles de la pandémie de COVID-19 ont cédé la place à des chocs géopolitiques – des guerres en Europe et au Moyen-Orient aux changements d’orientation en Asie – dont nous devons tenir compte lorsque nous évaluons la SIP et que nous nous assurons qu’elle est adaptée à son objectif à ce jour.
Ce qui a fonctionné : présence, profil et participation
En premier lieu, la SIP a indéniablement amélioré l’empreinte du Canada, notamment :
- Plateformes commerciales et financières. Exportation et développement Canada (EDC) a ouvert de nouveaux bureaux à Jakarta (2023) et à Séoul (2023), augmentant ainsi les services offerts aux entreprises canadiennes sur les marchés critiques et complétant les points de présence existants dans la région.
- Implantations sectorielles. Le premier bureau d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de l’Indo-Pacifique a officiellement ouvert ses portes à Manille en février 2024. Le Centre d’excellence en cybersécurité de BlackBerry en Malaisie, qui a ouvert ses portes en mars 2024, est un exemple concret de l’alignement des capacités canadiennes sur la demande des partenaires en matière de résilience cybernétique et de développement des compétences; une priorité de la SIP qui trouve un large écho dans toutes les économies en voie de numérisation de l’Asie du Sud-Est.
- Représentation régionale. Ottawa a également nommé un représentant commercial dans l’Indo-Pacifique et, dès la deuxième année de la SIP, a augmenté le personnel diplomatique, notamment en créant un réseau régional d’attachés cybernétiques et en recrutant des conseillers en matière de défense.
En deuxième lieu, l’engagement du Canada au niveau politique s’est accru. En 2023 et 2024, les nombreux déplacements du premier ministre et des ministres ont été le signe d’une plus grande attention de la part des hauts responsables, ce que nos partenaires ont remarqué. Les missions commerciales d’Équipe Canada (de grandes délégations multisectorielles conçues pour accélérer l’activité commerciale) ont été lancées à Singapour au début de 2023, suivies par le Japon plus tard dans l’année, puis par d’autres missions dans toute l’Asie du Sud-Est. Ces missions amplifient la présence canadienne et débouchent sur des résultats concrets pour les entreprises canadiennes.
Sur le plan diplomatique, cet engagement a permis au Canada et à l’ANASE d’élever leurs liens à un partenariat stratégique en septembre 2023, un cadre qui permet de favoriser une coopération sectorielle encore plus ciblée.
En troisième lieu, notre présence sur le plan de la sécurité a été renforcée. Dans le cadre de l’opération HORIZON, le Canada déploie désormais chaque année trois navires de guerre de la Marine royale canadienne dans la région indo-pacifique, participe à des exercices multilatéraux et se synchronise avec ses partenaires en matière de sécurité maritime, ce qui constitue un signe tangible du sérieux de son engagement.
Enfin, l’enveloppe de 2,3 milliards de dollars canadiens allouée à la SIP a permis de remporter des victoires anticipées sur des enjeux pratiques. Un exemple en est le déploiement du Programme canadien de détection des navires clandestins à l’appui de l’application de la législation maritime aux Philippines, un suivi par satellite en temps quasi réel qui permet aux autorités de lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et d’améliorer la connaissance du domaine maritime. Il s’agit du genre de contribution spécialisée dont les partenaires ont besoin et dont ils se souviendront.
Ensemble, ces éléments (nouveaux bureaux, visites et missions de hauts responsables, présence navale soutenue et financement d’outils qui permettent de résoudre les problèmes des partenaires) ont permis au Canada d’être plus visible et d’accroître sa participation régionale. Ils contribuent également à ce que le Canada soit perçu en tant qu’acteur constructif, conscient de ses valeurs et orienté vers le partenariat.
Lacune à combler : passer d’une stratégie à la stratégie
En dépit de ces progrès réels, la SIP a eu du mal à fournir une clarté stratégique. Le document est important, utile et complet, mais il ne répond pas directement aux questions fondamentales auxquelles toute stratégie devrait répondre, c’est-à-dire quels sont exactement les objectifs du Canada dans la région indo-pacifique et comment allons-nous tirer parti de nos ressources et de nos partenariats pour y parvenir? Les cinq objectifs sont tous valables et se renforcent mutuellement, mais les liens qui les unissent et les moyens de les atteindre doivent encore être clarifiés et définis.
Trois défis structurels se distinguent plus précisément :
1. Finalités et hiérarchisation des priorités. La SIP regroupe presque tout ce qu’Ottawa veut faire dans la région indo-pacifique, ce qui était logique pour ce premier effort pangouvernemental. Mais trois ans plus tard, le Canada a besoin d’une articulation plus étroite et plus ciblée des résultats d’intérêt national qu’il espère obtenir (p. ex. X pour cent de la croissance des exportations hors États-Unis en provenance des marchés indo-pacifiques; Y capacité de sécurité maritime offerte avec les partenaires A/B/C; Z nombre de secteurs stratégiques moins exposés aux risques grâce à une coopération plus étroite avec les chaînes de valeur des alliés), avec des contreparties et une mise en séquence explicites. Sans hiérarchisation des priorités, nous courons le risque que l’activité devienne une fin en soi.
2. Rapports à l’Inde et à la Chine. Alors que l’Inde était déjà assez peu prise en compte par la SIP, la crise diplomatique qui a suivi septembre 2023 en a fait un sujet assez controversé. Cette lacune est importante, car toute politique indo-pacifique sérieuse doit tenir compte de l’ampleur, de la croissance et du poids géopolitique de l’Inde, tout en continuant de prendre au sérieux les contraintes et les points de friction. En ce qui concerne la Chine, la SIP a souligné à juste titre la dissuasion, la réduction des risques et la nécessité de limiter les comportements préjudiciables de la République populaire de Chine. Mais ce cadre s’est avéré mal adapté à certaines régions de l’Asie du Sud-Est, où les partenaires se méfient des récits polarisants même s’ils se protègent contre les risques; ils accueillent favorablement les capacités canadiennes, mais préfèrent qu’elles soient fournies dans le cadre d’agendas positifs (p. ex. l’infrastructure, le climat, les compétences et le numérique) plutôt que dans une optique « centrée sur la Chine ». Notre message doit être centré sur les partenaires et sur la résolution des problèmes, tout en reconnaissant les préoccupations essentielles en matière de sécurité.
3. Alignement de l’ensemble de la politique étrangère. En l’absence d’une politique étrangère à jour qui définit les intérêts nationaux du Canada et sa tolérance au risque, ainsi que les niveaux de ressources que nous consacrerons aux différents domaines d’action, les stratégies régionales seront incomplètes. La SIP doit être intégrée à la position du Canada sur l’Arctique et à son engagement en région euro-atlantique. Ce n’est qu’à cette condition qu’elle reflétera les liens réels entre la sécurité du Pacifique Nord, de l’Atlantique Nord et de la région circumpolaire, ainsi que la dynamique de la chaîne d’approvisionnement.
Le contexte est important. Lors d’un important discours de politique étrangère prononcé à New York le 23 septembre dernier, le premier ministre canadien Mark Carney a souligné que les trois principales hypothèses qui ont façonné la politique du Canada pendant des décennies (un ordre fondé sur des règles qui a largement fonctionné pour nous, la sécurité collective grâce à l’OTAN et aux États-Unis, et les océans en tant que douves protectrices) ne peuvent plus être considérées comme acquises.
En bref, le Canada se sent aujourd’hui « moins sécuritaire et plus seul ». La réponse attendue est une plus grande habileté politique, des partenariats diversifiés et des investissements plus importants dans la diplomatie et la défense. La SIP est un instrument tout indiqué pour donner suite à ce diagnostic, mais seulement si nous précisons davantage ses objectifs.
Réviser sans réinventer : trois changements pour la prochaine étape
1. Faire de la résilience économique la logique organisationnelle
Le principal objectif économique du Canada dans la région indo-pacifique devrait être la diversification en profondeur : il ne s’agit pas seulement d’accroître le nombre de marchés, mais aussi de renforcer les positions sur le marché dans des secteurs stratégiques (p. ex. l’agroalimentaire, les minéraux critiques et la fabrication de technologies propres, les sciences de la vie et le numérique).
Voici ce que cela signifie concrètement :
- Traiter l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) comme une plateforme pour augmenter la présence et la sophistication sur les marchés prioritaires (p. ex. le Japon, le Vietnam et Singapour) et créer des liens délibérés entre le PTPGP et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (p. ex. des chaînes d’approvisionnement à double marché avec l’Europe pour les batteries, les petits réacteurs modulaires, l’hydrogène et l’agroalimentaire), de sorte que les entreprises puissent décider des normes et de la logistique pour les deux accords.
- Utiliser nos nouvelles implantations (le bureau d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Manille, les bureaux d’Exportation et développement Canada à Jakarta et à Séoul, et le représentant commercial du Canada dans l’Indo-Pacifique) pour des campagnes pluriannuelles visant à abaisser des barrières précises (p. ex. sanitaires/phytosanitaires, accès aux marchés publics, localisation des données), avec des objectifs mesurables pour chaque secteur
- Élargir les missions d’Équipe Canada en les dotant de moyens qui favorisent le suivi : équipes de gestionnaires de comptes sur le marché et mise en commun des services juridiques et de conformité pour les petites et moyennes entreprises, par exemple. Les mises à jour d’Ottawa montrent que ces missions peuvent avoir un effet catalyseur; la question est celle de la continuité de l’engagement et de la conversion des gains préliminaires en résultats plus durables.
2. Ancrer notre engagement dans des partenariats stratégiques, et pas seulement dans notre présence.
Le Canada devrait dresser une liste sélective de partenaires d’ancrage qui ont des intérêts, une confiance et une volonté politique forts et auprès de qui nous pouvons nous distinguer. Il pourrait s’agir de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de la Corée du Sud et de Taïwan, avec des coalitions portant sur des domaines précis (p. ex. la sécurité maritime avec les Philippines, Taïwan et le Japon; les chaînes de valeur des semi-conducteurs et des batteries avec la Corée du Sud, Taïwan et le Japon; et la capacité cybernétique avec Singapour et la Malaisie). Ces « clubs » devraient être conçus pour l’action, et pas seulement pour le dialogue. Le partenariat stratégique ANASE-Canada devrait servir de cadre diplomatique, avec des résultats issus de groupements plurilatéraux ciblés et très ambitieux avec les États membres qui le souhaitent.
3. Offrir une grande valeur ajoutée en matière de sécurité, avec une portée intelligente
Il est important de maintenir la cadence des trois navires de l’opération HORIZON, mais l’avantage comparatif du Canada réside dans ses grandes capacités spécialisées, c’est-à-dire la connaissance du domaine maritime, la détection des navires clandestins, la cyberinvestigation et la cyberattribution, la formation à la neutralisation d’engins explosifs, entre autres. Nous devrions institutionnaliser ces capacités sous forme d’offres permanentes à nos partenaires, notamment l’Indonésie, le Japon, les Philippines, la Corée du Sud, Taïwan et certains États insulaires du Pacifique, et lier ces offres à des exercices conjoints et à des protocoles de partage d’information.
État d’esprit et force : développer les compétences des Canadiens relatives à l’Asie et renforcer les liens civiques dans le Pacifique
La politique ne voyage qu’à la vitesse des gens. Les compétences relatives à l’Asie (la langue, la maîtrise de la réglementation, l’expertise sectorielle) doivent devenir une habitude canadienne plus ancrée. Voici ce que cela signifie :
- Développer les affichages sur le marché et les possibilités de rotation, non seulement pour les diplomates, mais aussi pour les membres des organismes de régulation, les responsables de l’approvisionnement et les experts en normes techniques.
- Soutenir la connectivité de la société civile par des initiatives comme des échanges de chercheurs, des jumelages de villes, des collaborations avec les médias et d’autres programmes visant à approfondir la confiance et la compréhension à des niveaux qui complètent le niveau gouvernemental.
- Investir dans les filières de talents pour que les Canadiens comprennent l’économie politique de l’Asie de l’intérieur, et pour que les partenaires considèrent le Canada comme un participant fiable et à long terme, et non comme un visiteur occasionnel.
Recadrer les chapitres sur le développement et le climat pour les adapter à la réalité d’aujourd’hui
Les chapitres de la SIP consacrés au développement et à l’environnement peuvent être reformulés sans renoncer aux principes, afin de mieux soutenir les objectifs économiques et de sécurité du Canada. Voici ce que nous devons faire pour y parvenir :
- Aligner nos outils d’aide au développement à l’étranger sur nos objectifs géoéconomiques. Le Canada n’a pas le luxe d’offrir une aide multilatérale purement sans intérêt s’il veut influencer les résultats dans une ère plus transactionnelle. Il faudra donc politiser l’aide ou sacrifier la qualité; cela signifie toutefois qu’il faut donner la priorité aux programmes bilatéraux et cofinancés (par opposition aux programmes principalement multilatéraux) qui font progresser les objectifs communs comme les infrastructures résilientes, la transition énergétique et les systèmes alimentaires, et créer une place à l’expertise et aux normes canadiennes. Ottawa s’est déjà engagée dans cette voie avec des initiatives ciblées d’infrastructures vertes et des partenariats sectoriels; la prochaine étape consiste à les mettre à l’échelle et à en définir l’orientation.
- Relier l’action climatique aux possibilités économiques. Utiliser les projets de financement climatique (p. ex. les améliorations en matière de transmission, les énergies renouvelables décentralisées, la décarbonisation des ports) là où la technologie et les services canadiens peuvent être compétitifs, en particulier en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam. Les partenariats émergents d’EDC constituent un bon point de départ.
- Affûter nos outils de pouvoir de convaincre. Des programmes comme celui de détection des navires clandestins montrent comment la technologie canadienne peut discrètement fournir des biens publics en mer tout en renforçant les règles. Ces mesures peuvent être associées à la formation, à l’aide juridique et au partage des données afin de renforcer les capacités à long terme.
Mise en œuvre : transformer l’activité en avantage
Pour transformer un élan en avantage durable, les mesures suivantes pourraient être envisagées :
- Nommer les résultats attendus. Publier une liste sélective de cinq objectifs en matière de résultats pour 2026-2030 (p. ex. croissance des exportations hors États-Unis en provenance des marchés indo-pacifiques; part des marchés publics canadiens remportés par les partenaires indo-pacifiques dans les chaînes d’approvisionnement alliées; effets concrets sur la sécurité maritime; étudiants devenus travailleurs qualifiés; nombre d’initiatives conjointes de normalisation menées à bien). Rattacher chacun d’eux à un service responsable et à une ligne budgétaire.
- Choisir des ancrages et concevoir des plateformes « minilatérales ». Pour chaque partenaire d’ancrage (Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Philippines et Corée du Sud), rédiger des accords triennaux comportant chacun de six à huit objectifs, axés, par exemple, sur la sécurité, le commerce et les talents. Rendre ces résultats publics et modestes en nombre et suivre les progrès sur une base trimestrielle.
- Faire preuve de précision en ce qui concerne les ressources. Réexaminer et réinitialiser le financement de base de la SIP à la lumière des signaux de la demande. Le montant initial de 2,3 milliards de dollars canadiens sur cinq ans constituait un versement initial important; l’étape suivante pourrait nécessiter une combinaison de nouvelle hiérarchisation des priorités et de nouveaux crédits afin de mettre à l’échelle ce qui fonctionne (p. ex. la cybernétique, la connaissance du domaine maritime et les installations de préparation des projets).
- Lier les domaines d’action. Construire des ponts pratiques entre le Pacifique Nord et la région nordique et entre le PTPGP et l’AECG, en harmonisant les routes maritimes, énergétiques, commerciales et de transmission de donnéess.
- Mesurer la conversion, et pas seulement la participation. Pour les missions commerciales et les visites de hauts responsables, publier des indicateurs de conversion (p. ex. contrats conclus, barrières réglementaires levées, projets pilotes lancés) dans les six mois suivant chaque voyage.
Conclusion : prochaines étapes
En trois ans, le Canada a renforcé sa présence dans la région indo-pacifique, ce qui n’est pas une mince affaire.
Mais la présence est un moyen, pas une fin. Le monde a changé; les hypothèses qui sous-tendaient autrefois la politique étrangère du Canada sont aujourd’hui contestées. Dans ce contexte, une SIP révisée, dont les priorités ont été réorganisées, qui s’inscrit dans une politique étrangère nationale claire, axée sur la résilience économique et des partenariats solides et qui s’appuie sur de véritables compétences relatives à l’Asie, peut aider le Canada à transformer son activité en un véritable avantage.
L’objectif pour les trois prochaines années est simple à formuler, mais difficile à atteindre : devenir un partenaire important dans la région indo-pacifique, un partenaire présent, qui résout les problèmes et contribue à façonner les résultats qui comptent pour la sécurité et la prospérité des Canadiens dans leur pays.
La Stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique (2022) prévoit un financement sur cinq ans pour l’établissement d’un bureau de la FAP Canada dans la région et pour de nouveaux programmes et initiatives à l’appui de la SIP.