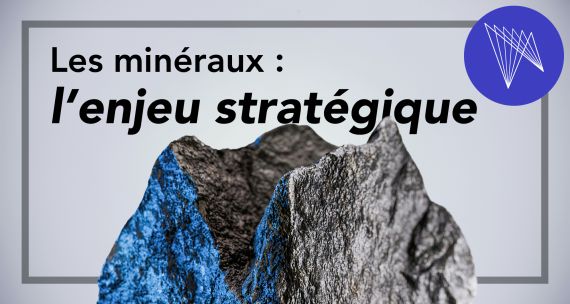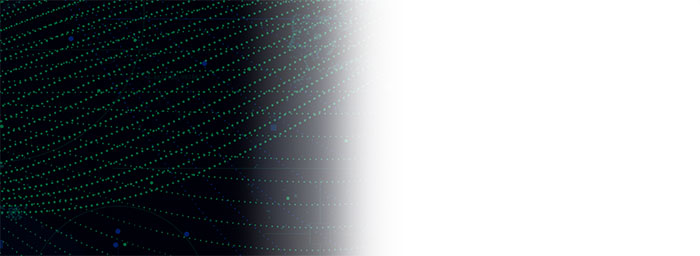Les tarifs douaniers provisoires de 75,8% pour antidumping imposés par la Chine sur les importations des graines canadiennes de canola ne constituent pas uniquement un litige commercial agricole, mais un acte indéniable de coercition économique. Annoncés quelques jours seulement après que des responsables chinois et canadiens se soient rencontrés pour discuter d’enjeux commerciaux, ces tarifs calculés pour exercer une pression maximale, survenant juste avant la récolte du canola et visant clairement à semer la division politique à l’intérieur du pays.
Beijing avait déjà imposé des tarifs douaniers de 100% sur l’huile et la farine de canola canadiennes, en représailles aux tarifs de 100% que le Canada a imposés sur les véhicules électriques (VE) chinois. Bien que ces tarifs soient qualifiés de « provisoires », la Chine garde la porte ouverte à une réduction, à condition que le Canada offre des concessions. C’est une tactique déjà vue, et c’est un piège dangereux.
En 2019, la Chine a mis en suspens les importations des graines de canola canadiennes en réponse à la détention de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, par le Canada, ce qui a entraîné des pertes de milliards pour les producteurs agricoles et exportateurs des provinces des Prairies. Le Canada n’est pas seul. D’autres démocraties ont fait face à l’instrumentalisation du commerce par la Chine comme arme géopolitique. Quand Beijing est mécontente, elle punit, de façon sélective et stratégique, pour maximiser ses outils de pression.
C’est pourquoi certains commentateurs et chefs politiques ont appelé le premier ministre Mark Carney à intervenir personnellement pour « résoudre » ce litige. Cependant, cette demande risque de faire manquer le point principal. La stabilité, la prévisibilité et le commerce fondé sur des règles ne sont pas possibles avec un partenaire qui utilise de manière répétée l’accès au marché comme moyen de pression. Tout « retour » à la normale est temporaire, ne durant que jusqu’au prochain désaccord.
Le calendrier et la cible de ces tarifs ne sont pas fortuits. En touchant les producteurs de canola quelques jours avant la récolte, la Chine cible le poumon économique des Prairies. Parallèlement, Beijing cherche à opposer les agriculteurs de l’Ouest au secteur automobile de l’Ontario et du Québec, industrie la plus engagée dans le maintien des tarifs sur les véhicules électriques chinois. Il s’agit d’une tentative préméditée pour diviser l’unité nationale canadienne et faire pression sur Ottawa pour obtenir un retrait anticipé.
Nous ne pouvons nous permettre de tomber dans le piège. Des concessions aujourd’hui ne feront qu’encourager de nouvelles exigences. Renoncer aux tarifs sur les véhicules électriques ne sera qu’une première concession parmi une série que Beijing chercherait à obtenir, compromettant ainsi notre capacité à protéger les industries stratégiques du futur.
Il est important de se rappeler les raisons pour lesquelles le Canada a imposé des tarifs sur les véhicules électriques chinois au départ. Ce n’était pas uniquement un acte de solidarité avec Washington. C’était une mesure pour protéger les intérêts nationaux du Canada, en protégeant notre capacité émergente de fabrication de véhicules électriques face à un torrent d’importations chinoises fortement subventionnées par l’État, qui pourraient compromettre notre sécurité économique, la cybersécurité et les objectifs des politiques industrielles. Protéger les secteurs critiques, comme la fabrication de véhicules électriques, fait partie des efforts pour bâtir une résilience nationale à long terme.
Même si Ottawa et Beijing parviennent à une résolution temporaire du différend sur le canola, le problème de fond persistera. Tant que l’économie du Canada dépendra autant d’un partenaire qui n’hésiterait pas à instrumentaliser le commerce (États-Unis ou Chine), nous resterons vulnérables à toute coercition future. La leçon de 2019, ainsi que l’expérience de l’Australie avec les tarifs chinois sur le vin, le charbon et l’orge, est claire : deux choix s’offrent à nous, diversifier ou être pris en otage.
Ce que le Canada devrait faire, en revanche, c’est fournir un soutien immédiat aux producteurs de canola tout en mettant en œuvre une stratégie à long terme pour atténuer les risques issus de la Chine aussi bien que des États-Unis, réduisant la dépendance excessive à un partenaire unique. En même temps, le Canada devrait développer des usages alternatifs domestiques pour le canola, par exemple comme biocombustible ou source de protéines végétales, afin de réduire la dépendance aux canaux limités d’exportation.
Renforcer le commerce fondé sur des règles par le biais d’ententes telles que le PTPGP, l’AECG ou de nouveaux accords de libre-échange avec des partenaires fiables en Asie et en Europe devrait être une priorité, tout comme l’investissement dans les capacités domestiques de transformation permettant de capter plus de valeur au pays. Aucune de ces mesures ne sera rapide ou facile à exécuter, mais elles sont essentielles pour que le Canada puisse résister aux prochaines tentatives de coercition économique que d'autres pays pourraient lui infliger, Chine ou autre.
La diplomatie avec la Chine devrait se poursuivre, notamment aux plus hauts niveaux. Le dialogue est important pour gérer les différends, préserver les canaux de communication et lutter contre les défis mondiaux communs. Mais il doit être ancré dans une compréhension lucide de la nature du Parti communiste chinois et de ses tactiques de pression. Reconnaître cela permettra de répondre stratégiquement, avec unité, résilience et un refus ferme de faire des concessions qui compromettraient notre souveraineté ou notre sécurité économique à long terme.
Les enjeux de ce différend dépassent largement le canola. Le message de la Chine est clair : elle n’hésitera pas à utiliser son poids économique pour parvenir à ses fins. Notre message devrait être tout aussi clair : Le Canada ne sera pas divisé ni mené à la coercition, et tracera sa propre voie fondée sur ses intérêts nationaux.
Cet article est paru dans The Globe and Mail le 18 août 2025.