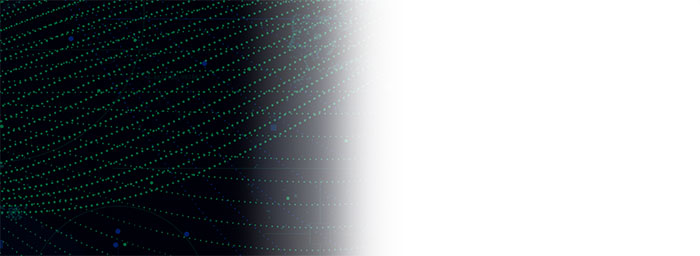La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a organisé la première édition du Forum sur l’Indo-Pacifique à Ottawa les 1er et 2 octobre 2025, près de trois ans après le lancement de la Stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique (SIP). Le Forum a réuni des intervenants du gouvernement du Canada, des universitaires, des experts de groupes de réflexion, des dirigeants du secteur privé et des chercheurs en politiques publiques de toute la région indo-pacifique afin d’évaluer les progrès accomplis et de formuler des recommandations concrètes sur la manière dont le Canada devrait adapter sa stratégie dans un contexte de profonds changements mondiaux.
Le premier jour du Forum, qui s’est tenu au Fairmont Château Laurier à Ottawa, a débuté par des réflexions sur l’évolution de la dynamique de sécurité dans la région. Le deuxième jour, qui s’est déroulé selon la règle de Chatham House, a porté sur quatre grands axes de l’engagement du Canada dans la région indo-pacifique : la paix et la sécurité; le commerce, la résilience économique et les chaînes d’approvisionnement; la sécurité énergétique, la technologie et l’innovation; le développement, l’éducation et la collaboration avec la société civile. Au cours de chaque séance, les participants ont passé en revue les objectifs initiaux de la SIP, fait le point sur les résultats obtenus et proposé des moyens d’adapter la stratégie afin de faire face aux perturbations majeures qui touchent le commerce mondial et la géopolitique.
Principales conclusions
- Adapter la SIP à une nouvelle ère conflictuelle. Le Canada a besoin d’objectifs plus rigoureux, de compromis plus clairs et d’un ordre explicite des priorités, passant d’une longue liste d’activités à un programme concis qui favorise la résilience et la sécurité économiques.
- Investir dans des « expertises de niche » qui ont une incidence considérable. Développer des capacités spécialisées, telles que la connaissance du domaine maritime (p. ex. la détection de navires clandestins), la lutte contre la désinformation, la cybersécurité et l’intervention en cas de catastrophe, et des formations ciblées en matière de sécurité avec des partenaires clés.
- Ancrer l’engagement dans une liste restreinte de partenariats stratégiques et minilatéraux. Approfondir la coopération avec l’Australie, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Japon, les Philippines, Taïwan, le Vietnam, tout en travaillant avec l’ANASE, s’il y a lieu.
Faire des liens interpersonnels le multiplicateur de force du Canada. Considérer l’éducation, la collaboration en matière de recherche et la connectivité de la société civile comme des investissements générationnels; moderniser les approches de l’aide au développement afin d’aligner les valeurs sur les résultats concrets dans le but de soutenir les objectifs économiques et de sécurité.
Vidéo des faits saillants d’Encore
1er octobre : débat public sur l’évolution de la dynamique de sécurité dans la région indo-pacifique
Le président et chef de la direction de FAP Canada, Jeff Nankivell, et la vice-présidente, Recherche et stratégie, Vina Nadjibulla, ont ouvert le Forum en soulignant que le monde était déjà en pleine mutation lorsque le Canada a lancé sa stratégie pour l’Indo-Pacifique en novembre 2022. Trois ans plus tard, le monde est confronté à un tout autre niveau de perturbation. Pour que le Canada reste une société sûre, stable et prospère, il doit accepter la nécessité de faire les choses différemment, en particulier dans son approche de la politique étrangère. Une mise à jour de la SIP sera essentielle pour aider le Canada à mener à bien ce processus. La SIP a été initialement conçue pour s’aligner globalement sur l’approche américaine dans la région. Aujourd’hui, il faut repenser cette approche à la lumière du fossé grandissant entre le Canada et les États-Unis, ainsi que des changements majeurs apportés par la nouvelle administration de Trump dans la façon dont les États-Unis perçoivent la région indo-pacifique et entretiennent des relations avec celle-ci.
Afin d’aider les Canadiens à mieux comprendre ces changements, le Forum a accueilli Victor Cha, Ph. D., président du département de géopolitique et de politique étrangère et titulaire de la chaire sur la Corée au Center for Strategic and International Studies à Washington, D.C., qui a prononcé un discours liminaire sur l’évolution du paysage de la sécurité dans la région indo-pacifique et sur l’approche de l’administration Trump dans cette région. Cha a fait remarquer que l’on assiste au retour de la concurrence des grandes puissances et à un abandon définitif du modèle stratégique qui a défini l’engagement de Washington envers la Chine pendant des décennies, à savoir un effort visant à faire de la Chine un acteur responsable au sein du système international. Pour les alliés, cela a créé une incertitude considérable; ils ne peuvent plus se protéger en se tournant vers la Chine pour renforcer les liens économiques ni vers les États-Unis pour renforcer les liens de sécurité.
Pendant ce temps, on assiste à une cohésion des autocraties mondiales, notamment la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’équivalent autocratique du Quad, a expliqué Cha, ces pays mènent des activités bilatérales et agissent en parallèle d’une manière qui devrait préoccuper le Canada, les États-Unis et les alliés occidentaux.
Les États-Unis et la Chine utilisent également le commerce et la finance comme armes et sapent les normes relatives au recours à la force comme forme légitime de politique. Cela se produit au moment même où les institutions mondiales s’effondrent : le Conseil de sécurité des Nations unies a dû mal à répondre aux crises majeures mondiales, l’OMC est incapable de gérer la militarisation du commerce et de la finance, le G20 n’est pas en mesure d’exercer une véritable gouvernance mondiale, et les BRICS (organisation intergouvernementale de 10 membres fondée par la Chine, l’Inde, la Russie et le Brésil) n’ont pas réussi à faire avancer un nouveau modèle pour le monde malgré leurs efforts pour créer de nouvelles « règles du jeu ».
Les États-Unis sont également en train d’abandonner leur vision paradigmatique de leurs alliés; alors que Washington considérait autrefois ses alliés comme un atout net, ils les considèrent désormais davantage comme un passif net. En revanche, les adversaires sont considérés comme des cibles attrayantes pour l’engagement. De même, Washington se contentait autrefois d’une réciprocité diffuse de la part de ses alliés, mais se concentre désormais sur les transactions et insiste sur une réciprocité spécifique, c’est-à-dire que les États-Unis n’agissent en faveur de leurs alliés que s’ils en tirent un bénéfice immédiat. Le regard que porte l’administration Trump sur ces alliés s’est considérablement rétréci; ces derniers ne sont plus appréciés pour leurs avantages en matière de sécurité et dans d’autres domaines, mais évalués selon deux critères : leurs dépenses militaires en pourcentage de leur PIB et leur balance commerciale avec les États-Unis.
Enfin, alors que l’on parle beaucoup de l’imprévisibilité de la politique étrangère de la nouvelle administration de Trump, Cha a déclaré que, à certains égards, le président américain est prévisible sur le plan stratégique mais imprévisible sur le plan tactique, notamment dans la manière dont il agit sur ces nouveaux indicateurs stratégiques.
Tout cela se traduit par une instabilité considérable pour les alliés. Cha a relevé certaines similitudes dans les réactions des alliés des États-Unis. Plus précisément, alors que beaucoup souhaitaient initialement résister, ils ont depuis tenté de conclure des accords avec les États-Unis et ont finalement pris conscience de leur responsabilité dans la préservation de leurs relations à long terme, travaillant directement avec Washington plutôt qu’entre eux.
Le général canadien (à la retraite) Wayne Eyre, s’appuyant sur ses décennies d’expérience et de leadership au sein des Forces armées canadiennes, a abordé les défis liés aux relations avec l’autre superpuissance mondiale : la Chine. Il a déclaré que la SIP avait « vu juste » en décrivant la Chine comme une puissance mondiale perturbatrice de plus en plus agressive dans ses relations avec les autres pays. Il a parlé de la « guerre cognitive incessante » que Beijing mène dans la région, en particulier à l’égard de Taïwan, où la Chine tente de semer le doute quant à la fiabilité du soutien occidental, à la compétence de l’armée taïwanaise et à la capacité des Taïwanais à faire confiance à leur gouvernement. Il a souligné que la Chine tente d’atteindre ce dernier objectif par le biais de campagnes de désinformation, notamment celles qui ciblent de manière très précise certains segments de la société taïwanaise.
Le général Eyre a fait part de son évaluation selon laquelle le président chinois Xi Jinping reste fermement déterminé à réunifier Taïwan avec le continent, ajoutant que les exercices militaires chinois sont de plus en plus complexes, mobilisent un plus grand nombre de forces et semblent viser à semer la confusion quant aux intentions et à savoir s’il s’agit d’un exercice ou d’une invasion. Une telle invasion serait difficile sur le plan militaire, a expliqué le général, ajoutant que Beijing privilégie la guerre juridique et fait porter le poids de l’escalade à d’autres. Il a laissé entendre qu’un conflit pourrait éclater au récif Second Thomas, dans la mer de Chine méridionale, théâtre d’un bras de fer de plus en plus tendu avec les Philippines.
Le général a précisé que le Canada a déjà fait l’expérience de l’agression militaire chinoise. Cela inclut des interceptions dangereuses et hostiles par ses avions et ses navires, qui se produisent avec une fréquence et une intensité croissantes. Le général Eyre a affirmé que le Canada partageait l’avis d’autres pays selon lequel ces actions visent à intimider et à décourager toute présence dans l’Indo-Pacifique. Il a toutefois souligné que, selon ses discussions avec les partenaires régionaux, la présence du Canada est en fait la bienvenue dans la région.
Le général Eyre a également mentionné que, bien que la présence du Canada dans la région se soit normalisée, notamment depuis le lancement de la SIP, elle a entraîné certains coûts, tels que la réduction des engagements du Canada envers l’OTAN. Le Canada doit néanmoins accroître son engagement dans la région indo-pacifique. Il a ajouté que, malgré ses capacités limitées, le Canada doit veiller à ce que ses engagements aient un rendement élevé, que ce soit en dissuadant ses adversaires ou en rassurant ses partenaires. En plus d’accroître ses investissements dans son infrastructure industrielle de défense, le Canada peut également faire davantage pour former et soutenir ses alliés et partenaires régionaux, comme il l’a fait dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.
2 octobre : Principales dimensions de l’engagement du Canada dans la région indo-pacifique (séances stratégiques à huis clos)
Séance d’ouverture
Au deuxième jour du Forum, les participants sont revenus sur les thèmes abordés la veille, à savoir qu’il est logique pour le Canada de se concentrer sur la région indo-pacifique à la lumière des changements majeurs dans le système mondial. Un participant a prédit que la SIP quinquennale actuelle serait bientôt considérée comme un prélude opportun à une phase d’engagement encore plus intense qui dépasserait largement les bases géographiques habituelles en Amérique du Nord et en Europe. Il a également été observé qu’il existe une forte convergence entre la SIP et deux des missions fondamentales du premier ministre Mark Carney : la diversification commerciale et la protection de la souveraineté canadienne.
Il a également été souligné que la mise en œuvre et la concrétisation de la stratégie doivent être le fruit d’un « travail d’équipe » impliquant des acteurs au-delà du gouvernement fédéral. Il faut également convaincre la population canadienne qu’une plus grande attention doit être accordée à la région indo-pacifique. Les rencontres au sommet d’octobre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ainsi que la première visite officielle du premier ministre dans la région, ont constitué un bon point de départ.
Première séance – paix et sécurité
Au cours de cette première séance animée par Vina Nadjibulla et comptant Ty Curran, Brent Napier, Jonathan Berkshire Miller, Vincent Rigby, Nane Baldauff et Suon Choi comme principaux intervenants, on a discuté des objectifs de la SIP en matière de sécurité, de ses résultats et de ses limites dans les trois dernières années, de l’évolution de la dynamique régionale sous la nouvelle administration américaine, ainsi que des recommandations visant à renforcer la dissuasion, la résilience et les partenariats. La professeure Stephanie Carvin a fait office de rapporteure.
Le ministère de la Défense nationale du Canada et les Forces armées canadiennes ont joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la SIP sur le terrain en renforçant leur présence militaire dans la région, notamment en augmentant de deux à trois le nombre de frégates déployées pour promouvoir la paix et la sécurité et en intensifiant la participation du pays aux exercices militaires interarmées avec ses partenaires régionaux.
Le Canada exerce également une influence considérable grâce à son programme de détection des navires clandestins, qui utilise la technologie satellitaire pour localiser les navires qui se déplacent sans système d’identification dans l’espace maritime d’autres pays. Cette technologie facilite également la surveillance du trafic commercial afin de prévenir les collisions, la surveillance des infrastructures sous-marines critiques et la lutte contre la pêche illégale, qui sévit dans certaines parties de la région. Un autre exemple illustrant comment le Canada tire parti de son « expertise de niche » au profit de ses partenaires régionaux est le déploiement de huit cyberattachés dans la région indo-pacifique afin de renforcer sa cyberdiplomatie bilatérale avec ses partenaires et sa participation à des événements régionaux clés en matière de cybersécurité.
Plusieurs participants de la région indo-pacifique ont confirmé que les efforts accrus du Canada étaient remarqués et appréciés. Le programme de détection des navires clandestins a contribué de manière significative aux opérations de surveillance maritime des Philippines. D’autres domaines de collaboration et de coopération ont été relevés. En Asie du Nord, le Canada et le Japon ont institutionnalisé leurs relations en matière de défense, notamment par la signature récente d’un accord bilatéral sur le partage de renseignements en matière de sécurité et par les négociations en cours sur un accord de transfert d’équipements et de technologies. La Corée du Sud et le Canada ont tenu leur toute première rencontre des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays en 2024. Un participant a fait remarquer que ces mécanismes d’engagement constituent des éléments importants dans une région qui ne dispose pas de structures d’alliance similaires à celles de l’OTAN.
Plusieurs suggestions ont été faites pour tirer parti de l’élan du Canada dans la région :
1. Développer les contributions du Canada dans des domaines et des capacités de sécurité spécialisés. Il faudra du temps au Canada pour développer des capacités militaires importantes; à court terme, il peut être un fournisseur encore plus important d’aide non traditionnelle en matière de sécurité dans des domaines tels que les interventions en cas de catastrophe, la lutte contre la désinformation, la cybersécurité, et le déploiement et la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA).
2. Intégrer les partenaires du Pacifique Nord dans la stratégie de défense de l’Arctique canadien. Ces partenaires considèrent le Canada comme une grande puissance arctique. L’approfondissement des relations avec le Japon et la Corée du Sud, y compris la coopération industrielle en matière de défense avec ces deux partenaires, peut être mis à profit à cet effet.
3. Renforcer l’aide maritime apportée aux Philippines afin d’y inclure une expertise en matière de vérification des renseignements. Cela aiderait le pays à créer une image opérationnelle commune à l’ensemble de ses agences maritimes.
4. Explorer les possibilités pour le Canada de se joindre au nombre croissant de groupements minilatéraux régionaux. Le Canada est plus susceptible d’être invité à se joindre à de tels groupements s’il peut apporter quelque chose à la table. Les Philippines pourraient être un partenaire clé à cet égard, étant donné qu’elles sont déjà membres de plusieurs groupements trilatéraux et minilatéraux.
Les participants ont également suggéré de repenser la défense et la sécurité dans le cadre de la SIP.
1. Ancrer la SIP dans une stratégie de sécurité nationale plus vaste. Le Canada dispose d’un éventail de stratégies régionales qui doivent être regroupées dans le cadre d’une stratégie cohérente et coordonnée en matière de politique étrangère. Les décideurs politiques à Ottawa devraient veiller à ce que la SIP reflète l’interdépendance croissante entre les théâtres de sécurité indo-pacifique et euro-atlantique. Un participant a aussi mentionné que la Politique étrangère du Canada pour l’Arctique (publiée en 2024) faisait pâle figure par rapport aux solides stratégies de plusieurs pays asiatiques, qui inscrivent leur engagement dans l’Arctique dans le cadre de leurs perspectives géopolitiques plus vastes.
2. Réévaluer la portée géographique de la participation du Canada aux initiatives de paix et de sécurité. Déterminer s’il serait préférable pour le Canada d’assurer une présence étendue dans la région ou de se concentrer sur le Pacifique Nord.
3. Reconnaître explicitement les liens entre le pilier de la sécurité et d’autres piliers, tels que le commerce et l’investissement.
4. Approfondir la compréhension de l’influence perturbatrice de la Chine et de l’ampleur de cette perturbation, y compris dans l’océan Indien, que l’un des participants a qualifié d’angle mort pour le Canada.
5. De même, reconnaître le rôle de l’Inde en tant que pilier de la sécurité régionale. Examiner si la présence et les déploiements du Canada pourraient s’étendre à l’océan Indien, compte tenu de l’importance des routes maritimes de cette région pour le commerce mondial et la sécurité énergétique.
Deuxième séance – commerce, résilience économique et chaînes d’approvisionnement
Au cours de cette séance animée par le professeur Patrick Leblond et comptant Sara Wilshaw, Karthik Nachiappan, Jessica Shadian, Don McLain Gill et Trevor Nieman comme principaux intervenants, on a examiné les objectifs de la SIP en matière de commerce et de chaîne d’approvisionnement, fait le point sur les résultats obtenus et les nouveaux défis, notamment la politique douanière des États-Unis et l’évolution des accords commerciaux régionaux, et exploré les options politiques visant à promouvoir la diversification et à renforcer la résilience économique. Le professeur Ari Van Assche a fait office de rapporteur.
La SIP a défini plusieurs objectifs principaux concernant ces questions géoéconomiques : diversification, promotion de la réglementation du commerce et renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement, avec pour objectif sous-jacent de soutenir la création d’emplois de qualité pour les Canadiens.
Plusieurs missions commerciales importantes organisées par le gouvernement fédéral ont été envoyées dans la région, a expliqué un représentant fédéral, et le Canada a renforcé sa présence physique. Il y a désormais des représentants commerciaux canadiens dans presque tous les marchés de la région, certains marchés accueillant des représentants commerciaux dans plusieurs villes.
Enfin, des progrès notables ont été accomplis en vue de la conclusion de nouveaux accords commerciaux. La signature récente de l’Accord de partenariat économique global avec l’Indonésie en est un exemple, tout comme le futur accord de libre-échange avec l’ANASE. Des progrès ont également été réalisés avec le Japon en matière de coopération dans le domaine de la défense et de l’énergie nucléaire, comme en témoigne l’intérêt de ce dernier pour les réacteurs classiques et les petits réacteurs modulaires du Canada.
L’engagement non gouvernemental a également été très actif. La Chambre de commerce du Canada collabore avec diverses chambres de commerce bilatérales nationales de la région et organise des missions commerciales plus modestes et plus sectorielles, menées par des entreprises.
Plusieurs participants ont attiré l’attention sur les tendances à long terme, en particulier en Asie du Sud-Est, qui offrent des occasions pour le Canada, notamment une démographie favorable, la croissance de l’adoption du numérique et l’accent mis sur les transitions climatiques et énergétiques.
Toutefois, malgré la liste croissante des réalisations du Canada et les investissements importants consentis pour soutenir le développement des exportations dans la région, une enquête récente suggère que de nombreuses entreprises canadiennes intéressées par de nouveaux marchés ne se tournent pas encore vers la région indo-pacifique.
Compte tenu de ces observations, les participants ont formulé les recommandations suivantes :
1. Continuer d’investir dans les infrastructures facilitant les échanges au Canada. Les entreprises canadiennes ont besoin d’un soutien adéquat, il faut les convaincre que la pénétration de ces marchés en vaut la peine et peut se faire sans trop de risques.
2. Conclure des accords ciblés avec des pays partageant les mêmes valeurs sur les questions numériques et environnementales. Alors que le commerce de marchandises entre le Canada et la région indo-pacifique (en particulier l’ANASE) a augmenté ces dernières années, le commerce de services est à la traîne. De nouveaux accords pourraient également tenter d’harmoniser les normes numériques.
3. Donner la priorité à l’investissement. Cela vaut également pour le Nord canadien, où il existe un besoin important d’investissements pour combler les déficits en matière d’infrastructures. Négliger le Nord favorisera l’instabilité en laissant un vide qui pourrait être comblé par des acteurs cherchant à s’implanter dans cette région, notamment des entreprises chinoises qui ont déjà acquis des participations dans des exploitations de minéraux critiques.
4. Aller au-delà des cadres bilatéraux pour la coopération dans le domaine des minéraux critiques. Le Canada doit également s’attaquer aux problèmes de coordination et d’information liés à la tarification, à la mobilisation des capitaux et à la transparence.
Troisième séance – sécurité énergétique, technologie et innovation
Au cours de cette séance animée par Jeff Nankivell et comptant Rachel McCormick, Nadir Patel, Tuvshinzaya Gantugla et Yujen Kuo comme principaux intervenants, on a passé en revue les objectifs de la SIP en matière d’énergie, de technologie et d’innovation, évalué les progrès du Canada dans les domaines des minéraux critiques, de l’énergie propre, de l’IA et des technologies émergentes, examiné les façons de s’adapter aux changements mondiaux en matière d’innovation et de politique industrielle, et proposé des priorités futures pour la collaboration et la préservation de la sécurité économique. Motria Savaryn-Roy a fait office de rapporteure.
La SIP a présenté plusieurs idées visant à renforcer la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement du Canada et de ses partenaires régionaux : créer un corridor commercial national, positionner le Canada comme un fournisseur d’énergies propres et renforcer les liens en matière de ressources naturelles avec les principaux partenaires de la région indo-pacifique.
Ressources naturelles Canada (RNCan) se trouve à la croisée de tous ces domaines. Les participants ont appris que le champ d’action de RNCan s’est élargi dans les dernières années. En effet, son champ d’action, qui portait principalement sur les questions scientifiques et économiques, englobe désormais les préoccupations géopolitiques et de sécurité. L’énergie et les minéraux critiques sont désormais au cœur de ces discussions. Le Canada représente un avantage pour les partenaires de la région indo-pacifique, car il est un fournisseur sûr et fiable d’énergie et de minéraux critiques et, pour certains pays de cette région, ses routes commerciales sont plus courtes que celles de ses concurrents.
En matière d’adoption des énergies propres, des signes de progrès ont été observés dans toute la région. Par exemple, l’Inde augmente rapidement son utilisation d’énergies propres et accélère le déploiement de l’énergie solaire et éolienne. La Corée du Sud a placé les semi-conducteurs à hydrogène au cœur de sa stratégie industrielle. Le Japon développe une politique nucléaire équilibrée avec les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, telles que les pôles d’hydrogène. En Asie du Sud-Est, le Vietnam est en train de devenir un pôle de fabrication pour les composants électroniques et les énergies renouvelables, l’Indonésie tire parti de ses réserves de nickel pour les chaînes d’approvisionnement mondiales en véhicules électriques, et Singapour s’est imposée comme un chef de file dans le domaine des technologies financières et de l’innovation numérique.
Quelles mesures le Canada a-t-il prises dans le cadre de la SIP pour tirer parti de ces possibilités? RNCan a augmenté sa présence sur les marchés japonais et sud-coréen, renforcé sa capacité à comprendre les occasions régionales et facilité les premières livraisons de gaz naturel liquéfié, de la côte ouest du Canada vers l’Asie. En outre, l’achèvement du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX) en 2024 a facilité les exportations de pétrole canadien vers les partenaires asiatiques. Des progrès ont également été réalisés à l’échelle nationale en matière de batteries et de mécanismes permettant au Canada de collaborer avec les pays de la région indo-pacifique dans des domaines technologiques tels que le captage du carbone, l’énergie nucléaire et l’énergie éolienne.
Un participant a fait remarquer que la sécurité énergétique et l’innovation technologique ne sont plus des domaines distincts, mais des domaines convergents de plus en plus intégrés. La transition vers les énergies propres nécessite non seulement de nouveaux carburants, mais aussi des infrastructures numériques, des matériaux de pointe et une efficacité basée sur les données afin de rendre les systèmes énergétiques fiables et abordables. C’est à cette intersection que les atouts du Canada peuvent avoir une incidence considérable.
À la suite de ce survol, les participants ont proposé les idées suivantes pour la prochaine phase de la SIP :
1. Se concentrer davantage sur les domaines où convergent les chaînes d’approvisionnement, l’innovation et la concurrence stratégique. Cela pourrait inclure l’élargissement de la gamme d’outils financiers à la disposition des entreprises canadiennes, notamment le financement des exportations, les garanties de crédit et les coentreprises.
2. Passer de projets ponctuels à des partenariats structurés et durables, en reconnaissant qu’aucun pays ne peut à lui seul gérer de grands projets liés aux minéraux critiques ou à l’énergie nucléaire ni financer raisonnablement un projet dans son intégralité. Parmi les idées de partenariats possibles, citons un corridor commercial entre le Canada et l’Inde pour les énergies propres ou un projet pilote entre le Canada et la Corée du Sud sur l’hydrogène et les matériaux de pointe.
3. Limiter le nombre de minéraux désignés comme « critiques ». À l’heure actuelle, le Canada compte 47 éléments « critiques », ce qui rend difficile l’affinement de ses politiques dans ce domaine. En outre, il faut remédier aux défaillances du marché pour les éléments qui font l’objet d’une très faible demande par utilisateur. Le Canada pourrait envisager de développer des outils en partenariat avec le G7 et d’autres partenaires afin de gérer la demande, notamment par l’entremise d’initiatives conjointes de constitution de réserves.
Quatrième séance – développement, éducation et collaboration avec la société civile
Au cours de cette séance animée par le professeur Victor Ramraj et comptant Sanjay Ruparelia, Bart Edes, Aries Arugay et Rohinton Medhora comme principaux intervenants, on s’est penché sur l’aide au développement du Canada, la collaboration en matière d’éducation et de recherche, et les liens interpersonnels, en prenant note de l’évolution du paysage de l’aide au développement et du rôle des États-Unis dans la région, et en identifiant les priorités futures pour le financement, les programmes et les partenariats du Canada dans la région indo-pacifique. David McKinnon a fait office de rapporteur.
La SIP a pris plusieurs engagements dans ce domaine, notamment élargir les échanges éducatifs, soutenir les organisations de la société civile, promouvoir la Politique d’aide internationale féministe du Canada, soutenir la durabilité dans la région, renforcer la capacité de traitement des visas et améliorer les initiatives en matière de développement des compétences et de droits de la personne.
Bien que les discussions du Forum aient principalement porté sur les relations bilatérales, la SIP est présentée comme un effort de l’ensemble de la société, ce qui suggère que les établissements d’enseignement supérieur canadiens, les organisations de la société civile et d’autres acteurs ont un rôle important à jouer, tout comme les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le succès de la SIP dépendra en fin de compte de la force des liens interpersonnels. Investir dans ces liens et dans les « compétences relatives à l’Asie » des Canadiens doit être un engagement générationnel. Certains participants ont fait remarquer que, bien que le Canada soit multiculturel dans sa composition, il n’est pas toujours international dans sa vision. De même, le Canada est un pays du Pacifique, mais il continue de penser principalement en termes atlantiques plutôt que pacifiques.
En ce qui concerne l’aide au développement international, l’évolution rapide du contexte mondial, notamment la réduction drastique de l’aide au développement accordée par les États-Unis, oblige le Canada à réfléchir à ses priorités dans la région. L’un des principaux intervenants a fait remarquer que, selon le dernier rapport de l’OCDE, le Canada est le sixième fournisseur d’aide publique au développement, mais que seul un faible pourcentage de cette aide est alloué à l’Asie. Un autre participant a souligné qu’il était essentiel de continuer à mettre l’accent sur le soutien aux droits de la personne, l’égalité des genres et la résilience climatique, même si de nombreux autres partenaires réduisent leur soutien dans ces domaines.
À la lumière de ces considérations, il a été noté que le Canada devrait :
1. Jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration d’un nouveau paradigme mondial pour le développement international. Si le Canada réduisait son aide au développement dans la région indo-pacifique, cela diminuerait son influence dans la région, en particulier à un moment où d’autres partenaires de développement – notamment les États-Unis, mais pas uniquement – réduisent leurs dépenses. Même si le Canada ne peut à lui seul combler le fossé du développement, il peut nouer des partenariats, notamment avec de nouveaux donateurs non occidentaux, intensifier ses activités avec les banques régionales de développement et trouver des moyens de tirer parti de son appartenance à des organisations internationales. De plus, il a été souligné que le Canada devrait examiner la part de son aide au développement qui est directement versée aux organisations de la société civile dans les pays bénéficiaires.
Dans le cadre de cette discussion, certains participants ont mis en garde contre la subordination de l’aide au développement du Canada à d’autres objectifs de politique étrangère, notamment le commerce. Dans le même ordre d’idées, un autre participant a expliqué que, dans les années 2010, l’agence canadienne d’aide au développement a été intégrée à un « super ministère » chargé des affaires étrangères et du commerce. Cela a eu pour effet de réduire l’importance et l’utilité de l’aide au développement canadienne dans la région indo-pacifique.
2. Continuer à soutenir les femmes et les filles, mais de manière plus discrète. Un participant a souligné qu’il existe une excellente occasion d’investir dans l’éducation des filles, ce qui aurait de nombreuses répercussions positives à long terme, comme l’augmentation du PIB d’un pays. Par contre, ces priorités doivent être présentées d’une manière qui ne donne pas l’impression d’être moralisatrice ou de suggérer que le Canada détient toutes les réponses.
3. Le Canada devrait également tirer parti de son leadership dans le cadre du Programme sur les femmes, la paix et la sécurité. Plusieurs participants de l’Indo-Pacifique ont affirmé que cette initiative mondiale menée par les Nations Unies était perçue positivement dans la région.
4. Acquérir une compréhension plus moderne et nuancée des populations de la diaspora indo-pacifique au Canada. Les diasporas indienne et chinoise sont importantes et en pleine croissance, et leur composition évolue d’une manière que bon nombre de Canadiens et d’entreprises et organisations canadiennes ne comprennent pas encore pleinement, notamment en ce qui concerne le profil socio-économique des nouveaux immigrants indiens.
5. Adopter une approche nationale pour rehausser le profil des universités canadiennes dans la région.
6. Renforcer la cohérence des politiques dans ces domaines. Le Canada aurait tout intérêt à adopter une stratégie de puissance discrète en lien avec les questions de puissance coercitive. Il pourrait également y avoir des efforts conjoints autour de la projection du pouvoir d’influence du Canada et de ses partenaires dans la région.